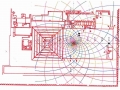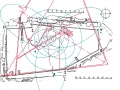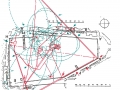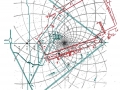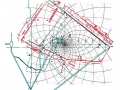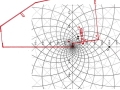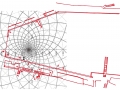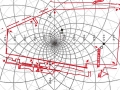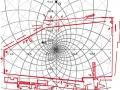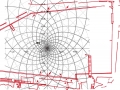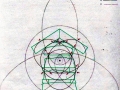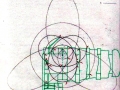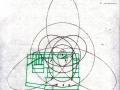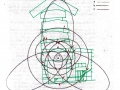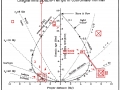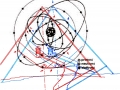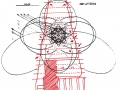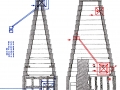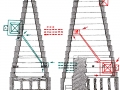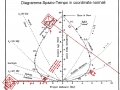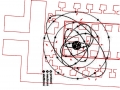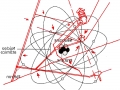LA PIERRE D’ALATRI
Au conte de José Louis Borges “L’IMMORTEL”
Dans les clapotements furieux des marées,
Moi, l’autre hiver plus sourd que les cerveaux d’enfants,
Je courus ! Et les Péninsules démarrées
N’ont pas subi tohu-bohus plus triomphants.
A. Rimbaud
PREMIÈRE PARTIE : Problèmes d’herméneutique historique associés à la datation des restes archéologiques
1. L’une des plus grandes difficultés de cette branche de la connaissance que l’on appelle « archéologie », familière pour des nombreuses personnes dès l’enfance mais en fait assez complexe et énigmatique, est celle de la datation certaine des restes que l’on découvre de différentes façons. Cela est vrai non seulement pour l’archéologie dans le sens strict, mais aussi pour l’histoire, quand on se sert des documents écrits qui appartiennent à des cultures qui ont une conception du temps et de l’espace différente de la nôtre. Pour donner au lecteur un exemple typique dans The Snefru Code, partie 1, nous avons analysé les problèmes herméneutiques qui nous sont posés par le relief qui décrit la victoire de Ramsès II à Kadesh. En particulier, nous nous sommes concentrés sur l’absolue impossibilité de prêter crédibilité au récit de la rencontre en champ de bataille avec l’armée hittite, qui aurait été défaite par le Pharaon tout seul sans la coopération de son armée. Alors nous nous sommes interrogés sur le sens profond que cette étrange histoire pourrait avoir ; une histoire qui nous semble presque incroyablement enfantine et qui donc difficilement peut être attribuée à des constructeurs d’œuvres architectoniques d’une perfection presque inhumaine, comme le temple de Luxor ou les Pyramides de Gizeh.
Mais il est clair qu’il y a des cas dans lesquels est plus facile de croire d’une façon immédiate au contenu des documents de l’Ancienne Égypte. Par exemple, dans un relief trouvé au pied du Sphinx on peut lire que Thoutmosis IV l’aurait fait restaurer après que le Sphinx lui-même lui était apparu en rêve, en lui promettant le royaume en échange de son travail de réparation. En ce cas il y a peu d’historiens qui ont mis en question la fiabilité de la nouvelle, qui ne contient pas, en fait, des éléments d’invraisemblance qui puissent alarmer notre sens commun. Bien sûr, certains peuvent penser que Thoutmosis IV a inventé de toutes pièces ce rêve pour des fins de propagande. Mais plus ou moins à tout le monde paraît probable qu’il ait fait effectivement restaurer le Sphinx, parce que, s’il ne l’a pas fait par dévotion, au moins il l’a fait pour obtenir la gloire et le consentement (il est remarquable que tout trait de cynisme puisse rendre immédiatement digestible n’importe quelle nouvelle historique même aux estomacs modernes les plus délicats : généralement les traits d’authentique dévotion religieuse nous semblent faux et discutables à priori, quand bien même se réfèrent à un peuple et à une époque où la religion était quelque chose aussi évidente et répandue que dans le présent c’est le culte du pouvoir come tel).
Mais, même si l’on prend pour bonne l’histoire qu’on lit dans le relief, dans ce cas comme dans d’autres semblables, tout ce que nous savons ou croyons savoir c’est que Thoutmosis IV a trouvé le Sphinx déjà taillé. De cela nous pouvons aussi déduire que sa mise en œuvre nécessairement a été avant son règne, mais reste ouverte la question, très fondamentale, de savoir qui l’a construit et quand. Et nous savons tous que cette situation d’ambigüité et d’obscurité est vraie pour la plupart de l’histoire de l’Ancienne Égypte, en particulier pour l’Ancien Royaume. En ce sens, les Pyramides de la soi-disant Quatrième Dynastie – notamment les trois qui, avec le Grand Sphinx sont les parties les plus importantes du complexe de Gizeh, ainsi que les deux de Dahshur – restent les cas les plus célèbres et inquiétants.
2. Dans la Grande Pyramide, dans une des soi-disant « chambres de décharge » ou « chambres supérieures » de la chambre du Roy, il y a la cartouche – c’est-à-dire une espèce d’écusson personnel – du Pharaon Khéops. Cette cartouche par l’archéologie officielle a été entendue comme un témoignage sûr que cet édifice a été construit par un Pharaon qui s’appelait Khéops, qui aurait régné en Égypte vers le 2600 av. J.C. Cela semble une chose évidente à des nombreux historiens, mais avec recul il peut ne pas être aussi évident qu’il paraît. En effet, la cartouche est prise comme une sorte de signature sur un document certifié par un notaire, dont on ne peut légitimement douter pour aucun motif. Comme si ce n’était jamais arrivé à personne de rencontrer un notaire malhonnête ou un document falsifié peut-être pour des raisons complètement innocentes (on peut penser, par exemple, à ceux qui sont utilisés pour faire un film ou une pièce de théâtre : peut-être juste pour une mise en scène sacrée).
En effet, si pour l’égyptologie officielle est évidente l’importance historique de cette cartouche, pour l’égyptologie indépendante la chose est moins claire. Sont nombreux les archéologues de ce courant qui pensent que, faute de plus amples informations, l’attribution de la Grande Pyramide a besoin d’une enquête plus approfondie. En effet, comment peut-on être sûr que le nom supposé de ce Pharaon n’était pas en réalité un de ses nombreux titres honorifiques, peut-être en référence à des qualités divines ou même à des divinités au sens strict ? En fin de compte, c’est ce qui se passe avec le nom « Ra » – le nom du dieu Soleil – qui apparaît comme la dernière partie de noms de Pharaons très célèbres, comme Khaf-Ra et Menkau-Ra, que habituellement nous appelons Khéphren et Mykérinos. Donc, en y regardant bien, on ne peut pas être sûr que le nom que l’on retrouve dans les chambres de décharge n’ait pas embelli d’autres souverains au cours de l’histoire de l’Ancienne Égypte. Une histoire qui aurait duré même plus de 30.000 ans, si nous écoutons tout ce que nous dit Manéthon et non seulement ce qui nous semble raisonnable en partant des préjugés évolutionnistes. Compte tenu de la tradition de l’Ancienne Égypte de restaurer des monuments très anciens, serait-il étrange si un souverain de 2600 av. J.C. ait pris ce nom propre pour s’attribuer un édifice qui existait depuis plusieurs millénaires ? Peut-être, tout comme Thoutmôsis IV, pour conquérir le royaume en force de la restauration qu’il a fait faire.
3. En effet, si nous avions à notre disposition une multiplicité de sources croisées de différentes sortes, la cartouche pouvait être la preuve définitive de la validité de l’ensemble des documents historiques que nous avons. Mais dans le cas des Pyramides de Gizeh nous n’avons aucun document de l’époque présumée de leur construction qui puisse donner un contexte et donc un sens achevé à la cartouche trouvée dans la chambre de décharge. Ni, dans ce cas, l’archéoastronomie serait d’une aide quelconque pour la datation du monument, comme on le croyait jusqu’à présent.
Comme d’ailleurs il fallait s’y atteindre, compte tenu de la nature des croyances de ces gens si différents de nous, dans The Snefru Code partie 5 nous avons découvert des preuves – qui dans leur ensemble ne semblent guère contestables – que la date à laquelle semblent faire allusion les puits de la Chambre du Roy et de ceux de la Chambre de la Reine ne correspondent nullement à un moment et à un fait historique dans le sens que le terme a en Europe occidentale. Par contre, tout comme le relief de Ramsès se réfère à un événement mythique-cosmique destiné à un éternel retour (le dieu qui se précipite en aide à l’ineptie de l’homme et qui se bat et gagne à sa place) l’inclinaison des puits vise à la section d’or d’un demi-cycle de précession de montée ou de descente à l’horizon de Sirius, Alnitaki, Kochab et Thuban. Mais, comme le cycle de précession et la section d’or étaient considérés sacrés, de même la section d’or d’un demi-cycle de précession a été elle-même considérée comme sacrée. Donc il est légitime de supposer que les puits visent à ce point du cycle de Sirius, Alnitaki, Kochab et Thuban pour des raisons qui n’ont rien à voir avec la date à laquelle ont été faits (et, comme nous le verrons bientôt, la datation par le carbone 14 confirme que la date « officielle » est incorrecte au moins de plusieurs siècles).
En fait, il semble complètement évident que la section d’or d’un demi-cycle de précession n’est pas du tout un moment historique dans le sens que le terme a en Europe occidentale, mais plutôt un moment des cycles cosmiques destiné à un éternel retour. Donc, il est tout aussi évident que le 2450 av. J.C. est juste l’une des dates auxquelles les puits font allusion. En plus de cette date, nous trouvons aussi le 18.500, le 23.500 ou le 31.000 av. J.C. (et, bien sûr, aussi le 10.500 après J.C., etc.). Ni une période comme le 31.000 av. J.C. nous la devons regarder trop ancienne comme date possible de la construction de la Grande Pyramide ou, au moins, de la fréquentation de Gizeh comme observatoire sacré-astronomique. Nous avons bien vu en The Snefru Code partie 6 que le culte stellaire auquel fait allusion la structure arquéoastronomique de la Chambre de la Reine a des points de contact très proche avec celui de la Chapelle des Lions et des Rhinos de Chauvet, qui a été réalisée juste autour de 31.000-32.000 av. J.C.
4. Il est clair que le défaut de considérer le point de vue des autres tend à provoquer des erreurs de perspective dans la lecture des documents et des personnages qui n’appartiennent pas à notre culture. Dans un contexte culturel tel que celui de l’Ancienne Égypte personne ne connaissait rien ni d’un temps linéaire ni de personnages et événements historiques uniques et qui ne se répètent pas, puisque ceux-ci, pour autant que nous le savons, sont une caractéristique pratiquement unique de la vision de l’histoire de l’Occident moderne. Par conséquent, dans un tel contexte, la cartouche avec le nom « Khéops » dit tout et ne dit rien, puisque les chances qu’elle se réfère à un individu sont pratiquement nulles.
Pour avoir une idée des malentendus possibles qui peuvent être générés en combinant d’une façon immédiate des figures de périodes historiques différentes nous pouvons faire un exemple très célèbre. Il n’est historien occidental qui n’est pas enclin à associer des personnalités comme Jules César et Napoléon Bonaparte. Et, en effet, l’association a un certain fondement et un certain pouvoir explicatif. Mais pour les gens de notre époque il est très facile d’oublier que si l’ambition de Napoléon Bonaparte était celle de laisser son nom à l’histoire, c’est-à-dire qu’on se souvienne de lui tout comme Napoléon Bonaparte (c’est-à-dire en tant qu’être humain unique et irremplaçable), un homme comme Jules César aspirait, au contraire, par ses entreprises à s’identifier et à être identifié avec Dionysos, comme autrefois avait réussi à faire Alexandre le Grand. Une chose logique, puisque dans les temps païens on croyait que pour devenir immortel il fallait en quelque sorte se confondre avec les dieux, qui sont les seuls êtres dans le cosmos qui ont le don de l’immortalité. Cette connexion intime avec le divin a été revendiquée par César aussi pour donner de l’éclat à sa maison : en fait, sans aucun sens de l’ironie il prétendait être un descendant de Vénus. Certes, peut-être qu’il ne le croyait pas et il le faisait uniquement à des fins de propagande, mais il est clair qu’il comptait sur le fait que les citoyens romains y croyaient, parce que la culture du temps acceptait tranquillement que les dieux s’accouplaient avec les humains et avec eux généraient des enfants.
Si on regarde de près, ces choses ne sont qu’apparemment stupéfiantes. Si l’on considère que dans la culture païenne, pourtant très différente de celle égyptienne, était encore vive l’idée d’un temps cyclique-mythique, où les mêmes personnages et les mêmes événements étaient destinés à revenir inexorablement, l’attitude de César nous semblera tout à fait évidente. Il a fallu un égocentrisme comme celui de Nietzsche – le plus occidental des philosophes occidentaux – pour croire qu’il était le premier à voir l’histoire comme un éternel retour des mêmes choses. Une idée qu’au temps des Grecs classiques était encore ordinaire comme l’eau.
5. Pour cette raison nous ne pouvons pas attribuer à la cartouche de Khéops une valeur explicative-probante supérieure à celle que légitimement on peut attribuer à la célèbre statue en diorite de Khéphren ou à celles de Mykérinos, qui à leur tour constituent les seules preuves selon lesquelles on peut attribuer un nom aux bâtiments de la deuxième et de la troisième pyramide de Gizeh. Dans ces cas, la certitude absolue avec laquelle l’égyptologie officielle donne pour sûres ces attributions semble vraiment surprenante, compte tenu particulièrement du fait que ces statues ont été trouvées dans les Temples de la Vallée et non dans les Pyramides. On ne comprend vraiment pas comment aucun professeur ait eu l’idée qu’elles ont été disposées à cette place dans une époque beaucoup postérieure, peut-être pour des raisons que nous ne sommes pas capables d’imaginer clairement. Que dirions-nous si, dans cinq ou dix ou quinze mille ans – quand les pierres tombales et les documents écrits seront usés – quelqu’un dirait que Rome a été construite par les anciens Égyptiens, parce que dans une de ses places principales on a trouvé un obélisque parfaitement conservé (il faut se rappeler qu’en cette période future l’obélisque sera plus ou moins l’unique monument qui peut avoir la chance d’être encore intact) ?
On aurait un malentendu plus ou moins égal si l’on attribuait à Marc Aurèle les palais relativement modernes qui entourent actuellement son monument équestre ou à l’époque de Caravaggio les systèmes électriques des musées où sont gardés ses tableaux.
6. Nous avons apporté à titre d’exemple le cas des Pyramides de Gizeh juste parce qu’il s’agit d’un cas célèbre, qui généralement est connu assez bien par toute personne intéressée même de façon non particulièrement profonde aux problèmes gnoséologiques liés à l’archéologie. Mais partout dans le monde on peut rencontrer des reste très importants totalement ou presque totalement muets. Si l’on creuse un site tout ce qui peut être obtenu avec les méthodes traditionnelles est une stratigraphie de ce que l’on a trouvé. De cela on peut atteindre une datation relative des découvertes assez fiable, au moins pour ce qui se réfère à la même famille ou à la même zone, mais rien de plus.
Mais, bien qu’intéressantes, ces conclusions sont totalement inutiles pour déterminer une date absolue. Supposons que dans une grotte paléolithique on trouve dans deux couches successives tout d’abord des coquilles et puis des dents de lion percées. De cela on peut déduire que les coquilles ont été utilisées comme décoration dans un temps successif aux dents ; et jusqu’ici on est tous d’accord. Mais à quel temps remontent ces pièces, à 10.000, 20.000, 30.000 ou 70.000 ans av. J.C. ? Le problème tout d’abord ne peut pas paraître très important, mais, au contraire, il est relié à des problèmes herméneutiques et historico-philosophiques de toute importance. Si un certain type d’objets doit être placé – par exemple – dans le 15.000 au lieu de 2500 av. J.C., il y a des entiers chapitres de nos livres d’histoire, d’archéologie et de paléontologie qui devraient être réécrits. Et si on devait les dater encore avant – de 100.000 ou 200.000 ans – alors sauteraient forcément non seulement certains chapitres, mais l’ensemble de notre vision du monde et de l’histoire.
7. En ce sens, il est devenu assez célèbre le cas des outils de pierre trouvés dans Hueyatlaco (Mexique) dans une couche géologique qui – testée par des méthodes quantitatives généralement considérées comme fiables – a été jugée encore plus ancienne que le 200.000 av. J.C., bien que certains résultats peuvent pousser la date jusqu’au 570.000 av. J.C.
Vis-à-vis de ces nouvelles la communauté académique a eu une réaction plutôt étrange. Au lieu de prendre acte que les idées communément admises à l’égard de l’évolution et à la diffusion du genre humain sur la terre étaient devenues discutables (jusqu’à ce moment on croyait que l’homme était arrivé en Amérique du sud de l’Afrique à une date entre 10.000 et 15.000 av. J.C.) on a pensé bien d’intimider de différentes façons tous ces chercheurs qui n’étaient pas disposés à rétracter ou adoucir les résultats de leurs recherches. Pourtant ces scientifiques jusqu’à ce moment étaient considérés influents et fiables, autrement personne n’aurait pris la peine de trouver l’argent pour les faire venir des États-Unis au Mexique pour effectuer des stratigraphies, des tests, etc. Qu’était-il arrivé parce que soudain des savants estimés s’étaient tournés en incompétents ou en loufoques ou même en mégalomanes frauduleux, prêts à fausser les résultats de leurs tests afin de gagner une journée de notoriété ?
Il convient de souligner que pas tous ces scientifiques se sont pliés aux injonctions et aux menaces de la communauté académique. Cela à fait en sorte qu’une géologue – Virginia Steen-McIntyre – coupable d’avoir publié les résultats de ses analyses, en dépit des avertissements reçus, d’abord a été expulsée de son université et puis mise à l’écart par la communauté scientifique. De cette façon, sa carrière universitaire a été inopinément et tristement terminée pour des raisons qui, bien qu’apparemment peuvent sembler scientifiques, au niveau plus profond peuvent au contraire être considérées comme typiquement religieuses.
Nous disons cela parce que ce type de comportement nous fait soupçonner que la date « standard » que la paléontologie académique attribue à la colonisation de l’Amérique du sud par l’homme ne soit pas vécue comme une donnée scientifique, soumise à falsification et à correction. Au contraire, il semble qu’elle est considérée et défendue comme un dogme. Un des nombreux dogmes de la soi-disant « théorie de l’évolution », qui en robes « rationalistes » de théorie scientifique, ne semble en réalité qu’une étrange sorte de foi religieuse. Une foi qui, tout en ne promettant aucun genre de salut, accorde toutefois des privilèges à ceux qui deviennent des disciples orthodoxes. Par exemple, le privilège d’occuper une place dans la hiérarchie qui garde la foi académique et à partir d’une telle position « d’autorité » avoir le pouvoir d’ostraciser tout chercheur ou même toute donnée empirique qui pourrait le contredire, y compris les données empiriques obtenues au moyen de tests dérivés même de la physique, la reine des sciences empiriques. En fait, il n’est pas historien qui ne se rend pas compte comment dans ce cas, la communauté scientifique (« scientifique » ?) se comporte envers un de ses membres comme l’Église catholique détestée et réactionnaire aurait fait jadis envers un hérétique (il faut pourtant dire que, à l’heure actuelle, l’Église catholique est beaucoup moins intolérante d’un certain type de « rationalisme »).
8. Le problème de la datation des restes archéologiques semble donc de la plus grande délicatesse et importance, au moins en raison des conséquences personnelles qui menace d’avoir pour les scientifiques et les intellectuels dissidents. Désormais il semble certain que des réponses fiables ne peuvent être trouvées en s’appuyant à des moyens purement critico-esthétiques. Pour faire un exemple encore une fois célèbre, les peintures de la Grotte de Chauvet à notre jugement esthétique apparaissent d’une facture beaucoup plus raffinée que celles de cultures de cinq ou dix millénaires plus récentes (peintures comme celles de Pech-Merle, par exemple). Même, dans certains détails de ces peintures on peut noter que les peintres de Chauvet devaient avoir un sens de la perspective plutôt développé, quoique à un niveau qui semble juste instinctif. Pourtant on sait que les peintures de Chauvet sont parmi les plus anciennes qui nous a légué l’art figuratif, étant donné qu’elles remontent même à 32.000 ans av. J.C. Maintenant, s’il est vrai que l’histoire naturelle et humaine est une histoire évolutive, c’est-à-dire une succession plus ou moins rapide de progrès, pourquoi la technique de la peinture à partir de ce moment-là a eu ce qu’on dirait une involution ? Comment est-ce que seulement au temps d’Altamira et de Lascaux elle a récupéré les capacités développées quinze millénaires avant ?
9. Ce problème, cependant, pourrait être mal posé, parce que, avec le recul, un produit artistique qui nous semble « raffiné », « évolué » et « développé » peut ne pas sembler tel à peuples de cultures différentes de la nôtre. Si un chinois du XIXe siècle avait écouté une symphonie de Beethoven peut-être il aurait perçu seulement une assourdissante cacophonie composée – qui sait – par des sons ou des bruits ou de toute autre chose. Pourtant, des nombreux historiens occidentaux pensent que jusqu’au XVIe siècle la Chine était le pays culturellement et technologiquement le plus avancé dans le monde.
De même, l’architecture de l’Europe occidentale ne semble pas adaptée pour exprimer l’âme de peuples qui ont un sens de l’espace radicalement différent du nôtre. En Chine et dans les cultures voisines on voit que la forme des toits des temples et d’autres édifices monumentaux sacrés est souvent caractérisée par un profil courbe, avec des bords qui « rebondissent » vers le haut avec une courbe similaire à celle de la partie descendante. Cette forme (qui dans certains cas se trouve aussi dans les casques des armées de l’âge de fer) semble faire allusion à une vision de l’espace telle que les notions de haut et de bas ont tendance à glisser l’une dans l’autre. Ainsi, des bâtiments tels que ceux que nous voyons dans l’image ci-dessous semblent nous dire : le haut tend vers le bas et le bas tend vers le haut


Cette vision de l’espace architectonique sacré a naturellement une signification spirituelle profonde. Elle nous rappelle en premier lieu « Le Livre des Changements », dans lequel le monde est considéré comme une transition d’un contraire à l’autre ; mais elle nous rappelle aussi le Tao-The-King. Ainsi que le saint taoïste gouverne le royaume (c’est-à-dire joue un haut rôle) en occupant la position la plus humble (c’est-à-dire la plus basse), de la même manière l’espace architectonique des temples tend à assimiler les directions opposées. Le bas pointe vers le haut et donc en germe contient la hauteur. Le haut pointe vers le bas et donc en germe contient la bassesse. En général, nous voyons que dans l’ancienne culture de la Chine – tout comme dans la philosophie d’Héraclite – tout contraire contient son contraire.
Rien ne pourrait être plus loin de l’esprit de l’Europe occidentale, dont le symbole plus puissant est sans doute la violente tension monodirectionnelle typique des cathédrales gothiques, qui font allusion à un élan vers le haut et vers l’infini, qui en principe ne peut jamais revenir sur lui-même. Est-ce que les deux structures que l’on voit dans les photos ci-dessous peuvent signifier quelque chose d’autre ?


Il faut remarquer que cette interprétation de l’espace architectonique sacré correspondait parfaitement à l’interprétation gothique du christianisme en tant qu’expérience spirituelle. Ce qui a signifié que, par exemple, jusqu’à l’événement du Pape François, les dirigeants de l’Église ont occupé toujours et de toute façon la place la plus élevée et se sont adressés aux fidèles toujours et de toute façon – en fait – de haut en bas. Chose tout à fait logique, puisque dans cette vision du monde un mélange des autorités et des personnes du peuple était impossible, au moins à l’égard de la structure hiérarchique et donc de la gestion du pouvoir temporel et doctrinal. Il est vrai qu’au niveau spirituel des nombreux saints ont exercé une très puissante influence justement parce qu’ils se sont dépouillés de tout pouvoir et de toute richesse. Mais ceux-ci (pouvoir et richesse) devaient, par contre, rester comme un attribut de tout sujet appartenant à la hiérarchie elle-même, qui plus était placée en haut d’autant plus devait augmenter ces attributs – qui en ce sens n’étaient nullement « mondains » – pour confirmer ainsi son éloignement du monde commun et sa proximité au divin.
Il semble donc clair que la papauté de François indique un tournant qui marque une époque de l’Église, qui se prépare à une interprétation de l’Évangile qui, vraisemblablement, aura peu à voir avec l’interprétation gothique, qui deviendra bientôt un passé on ne sait pas si glorieux ou inconfortable.
10. De telles considérations nous donnent à comprendre que des concepts tels que « progrès », « évolution » et similaires doivent être compris par un historien à l’esprit réellement ouvert dans une façon un peu moins absolutiste que celle de plusieurs intellectuels occidentaux. Peut-être dans le monde il n’y a pas et il n’y a jamais eu une et une seule ligne d’évolution, naturelle ou humaine. Peut-être soit la nature soit l’homme depuis toujours se développent dans des multiples directions, différentes ou parallèles, dans une succession de formes comparables mais toujours irréductiblement uniques et différentes.
Donc, on ne peut pas se surprendre si dans The Snefru Code partie 7 dans la conception de la Grande Pyramide nous avons trouvé des traces de la théorie des champs unifiés, qui même aujourd’hui nous ne sommes pas en mesure de développer. Cette découverte montre que la science empirico-mathématique n’est pas un patrimoine exclusif de la modernité. Ni, par conséquent, elle ne représente un point d’arrivée irréversible de la connaissance humaine : elle a existé sous une autre forme depuis des milliers et des milliers d’années, a été oubliée, puis a été réinventée. Il est donc très probable que dans l’avenir son sort sera encore une fois le même. En effet, en notant ce qui est arrivé dans le passé, il n’est pas difficile d’imaginer que dans des milliers d’années les hommes vont oublier tout ce qu’ils sont appris, et qu’ils vont l’apprendre à nouveau, peut-être sous une forme un peu différente. Et, bien sûr, ils vont croire à nouveau, comme nous l’avons cru, d’être les premiers qui découvrent et maîtrisent les secrets de la nature au moyen des mathématiques.
Montrer que la conviction de l’absolue unicité et supériorité scientifique de notre culture n’est qu’une illusion : n’est-il pas ceci finalement le sens de notre recherche ? Que des civilisations qui ont atteint un degré de connaissance scientifique égal ou supérieur au nôtre ont existé et disparu sans que jusqu’à présent on ait eu idée de leur existence : n’est-il pas justement ceci que nous avons été en mesure de démontrer ? Ainsi, le sens de l’homme dans l’univers et dans l’histoire va bien au-delà des limites étroites imposées par l’évolutionnisme. Au contraire. L’évolutionnisme même se révèle finalement comme une idée enfantine et pré-critique de l’Occident, qui est encore à ses débuts de la compréhension du passé profond de l’humanité et donc aussi de ses propres origines – et de son propre destin.
DEUXIÈME PARTIE : Le test du carbone 14 et les problèmes gnoséologiques associés à son application
1. Reprenant le fil du raisonnement historico-herméneutique que nous avons fait au début de cet article, il faut rappeler que la condition de l’extrême incertitude à l’égard de l’âge absolu des restes archéologique a duré jusqu’aux années soixante du dernier siècle, quand on a trouvé le moyen de résoudre le problème de la datation des restes sur la base de la décroissance du carbone 14. Cette nouvelle méthode, même si elle a forcé des paléontologues et des archéologues à réviser à plusieurs reprises des datations que l’on croyait certaines, n’a pas encore atteint tous les sites archéologiques indistinctement. Cela est arrivé parce que la méthode fonctionne uniquement avec des restes de nature organique et il est impossible de l’appliquer lorsque il s’agit de dater des restes comme la pierre, la terre cuite ou les métaux. Ce type d’objets ne sont pas directement datés, mais indirectement par induction, c’est-à-dire quand il est possible de les associer avec une raisonnable certitude à des reste de nature organique. Mais cela ne se produit pas toujours et, en fait, il y a des cas extrêmement importants pour la discussion historico-archéologique dans lesquels on ne trouve pas moyen d’obtenir des conclusions dignes d’intérêt.
C’est le cas de tous ces endroits où les structures supposées très anciennes ont été occupées et réutilisées par des populations successives à celles qui les ont construites. De cette manière le site subi ce que l’on pourrait appeler une « pollution biologique » ; et en ce cas le test du carbone 14 ne peut pas être digne de foi. Pour donner un exemple facilement compréhensible : si quelqu’un pensait de pouvoir dater la cathédrale de Milan sur la base d’un test effectué sur une chaise de bois achetée dans les années soixante, il établirait de façon absolue l’âge de la chaise, mais non l’âge de la cathédral. La même chose se produit chaque fois que des nouveaux peuples s’emparent des constructions de ses prédécesseurs peut-être complètement inconnus. Les nouveaux habitants ont tendance à effacer les traces biologiques des vieux habitants : ainsi le test du carbone 14 se trouve toujours et de toute manière à faire avec des restes qui appartiennent à des cultures plus récentes et jamais ou presque jamais aux cultures originaires.
2. Cela semble être une fois de plus le cas de la Grande Pyramide de Gizeh. Quand près de la Grande Pyramide on a trouvé un reste qu’on a jugé du 5000 av. J.C., cette découverte n’a pas eu des conséquences pratiques de type historico-théorique. Cela est arrivé parce que, quant au reste, la généralité des découvertes indique toujours et de toutes manières des dates successives, que l’on croit qui peuvent confirmer les idées courantes à l’égard de l’histoire de l’Ancienne Égypte. Mais demandons-nous : comment pouvons-nous être sûrs que les restes d’époques même beaucoup plus anciennes (comme le 7000 av. J.C., qui plus ou moins correspond à l’époque du Cercle de Nabta Playa) ne sont pas été détruits et/ou couverts par ceux d’époques successives (donc aussi par ceux du 5000 av. J.C.) ? Il est bien évident que des certitudes de ce genre sont impossibles.
Le test du carbone 14 réalisé sur des fragments organiques extraits directement de la Grande Pyramide et d’autres édifices voisins à son tour a donné des résultats contradictoires. Bien que dans des nombreux cas il a indiqué systématiquement une date autour de 3100 av. J.C., dans un cas, cependant, a signalé une date plutôt inquiétante : 3800 av. J.C. Évidemment aucun professeur ne sait qu’en faire d’une telle datation, puisque l’égyptologie académique place la construction des Pyramides de la IVe Dynastie à une date autour de 2500 av. J.C. D’autre part, même ceux qui pensent que ces Pyramides appartiennent à un âge beaucoup plus ancien ne sont pas enclins à prendre en considération cette découverte. Des nombreux archéologues en fait acceptent les idées de John Anthony West et retracent l’origine des Pyramides à un âge autour de 10.000-11.000 av. J.C. ou même encore avant. Ainsi le 3800 av. J.C., vu qu’il n’appuie les idées de personne, a été rapidement mis en veilleuse. Comme si le test du radiocarbone – c’est-à-dire un procédé scientifique dont les résultats sont en général jugés objectivement et incontestablement certains –dans ce cas particulier n’avait aucun sens.
Par contre, si l’on prend au sérieux cette découverte, on pourrait ou même on devrait se demander si la construction des Pyramides de Gizeh n’a pas eu son début 1300 années avant la date « canonique » (c’est-à-dire en 3800 plutôt qu’en 2500 av. J.C.). Deuxièmement, on devrait se demander si les travaux n’ont pas été conclus environ six siècles plus tôt qu’on ne le croyait jusqu’à maintenant (comme suggèrent des nombreux restes qui indiquent comme résultat le 3100 av. J.C.). À ce stade, non seulement nous serions forcés de reculer la date des Pyramides, mais aussi de mieux calculer le temps qui a été nécessaire à leur construction : de quelques décennies à au moins sept siècles (une période de temps qui entre autres apparaît un peu plus raisonnable que les vingt années qui habituellement on attribue à un exploit inhumain comme celui de construire la Pyramide de Khéops).
Mais, bien sûr, une fois qu’on a rompu la digue de l’interprétation traditionnelle, nous pourrions aussi nous poser un autre genre de question. À savoir : l’intervalle de temps défini par ces dates – c’est-à-dire l’intervalle entre le 3800 et le 3100 av. J.C. – fait-il référence à la construction des Pyramides ou à leur restauration ? Et s’il se réfère à leur restauration, quel est le fondement pour établir la date à laquelle les travaux ont initiés pour la première fois ?
Encore une fois, personne ne peut raisonnablement dire qu’il y a des certitudes solides et définitives à ce sujet, surtout si l’on considère que lors de la réunion des géologues américains en 1991 a été acceptée la thèse de West et Schoch, à savoir que les signes d’érosion sur le Sphinx sont explicables seulement par des pluies torrentielles. Cette nouvelle théorie a causé une crise radicale de la datation traditionnelle du monument, parce qu’en Égypte on a eu des pluies de ce genre seulement jusqu’à 7000 av. J.C. Ainsi, non seulement on doit antidater de beaucoup de millénaires la construction du Sphinx, mais aussi et surtout l’utilisation du Plateau de Gizeh comme lieu de culte.
3. Nous avons une situation similaire aussi en Cuzco, Sacsaywaman, Macchu Picchu, et en bien d’autres places précolombiennes. Ces sont des cas, où même un œil non expérimenté peut immédiatement remarquer une importante discontinuité technique et stylistique entre les structures construites par les Incas et celles dont les Incas – interrogés par les conquistadores – vigoureusement rejetaient la paternité, en disant que « bien sûr » elles avaient été fabriquées par les dieux en époques lointaines. On doit reconnaître que c’est une réponse qu’aucun archéologue occidental – académique ou indépendant – n’est pas prêt à prendre pour bonne, aussi parce que dans nos pays personne ne croit plus aux dieux depuis au moins quinze siècles (tout au plus il y a quelqu’un qui est prêt à croire que la tradition des Incas appelle divinités ceux qui pour nous sont des plus rassurants extra-terrestres). Peut-être c’est pourquoi l’archéologie académique, puisqu’elle n’a pas d’autres candidats, a jugé bon d’attribuer même les gigantesques monuments aux Incas, sans trop se soucier pour justifier le fait qu’eux-mêmes en refusent la paternité.
Maintenant, ce ne semble pas une position que l’on pourrait définir scientifiquement fondée. Tout d’abord, nous observons qu’il n’y a aucune nouvelle que les Incas eux-mêmes aient jamais montré qu’ils possédaient la capacité de construire des monuments de ce genre ou même de les savoir restaurer. En effet, on constate que quand les gigantesques structures avaient des vides, ils étaient systématiquement remplis de pierres de petite taille encastrées ou cimentées entre elles de façon approximative. Donc, si ces monuments n’ont pas été construits par les dieux, probablement on doit les attribuer à des cultures qui n’ont rien ou presque rien à voir avec la culture Inca.
Malheureusement, cela semble aussi être un cas où il semble complètement inutile la tentative de résoudre le problème avec le test du carbone 14. Puisque ces sites pendant des nombreux siècles ont été occupés par des populations relativement récentes, le matériel biologique qui peut se trouver appartient presque en principe à ces populations, qui sont précisément celles qui affirment que ce sont les dieux qui ont construit ces murs cyclopéens. Par conséquent, la discussion sur ce sujet pour le moment ne peut être effectuée qu’au niveau de la comparaison du style et, surtout, de celle des différentes techniques de construction connexes aux différents styles.
4. En fait, à plusieurs reprises et de plusieurs côtés il a été remarqué comme les constructions que les Incas attribuaient à leur initiative manquent totalement de ces traits cyclopéens qui par contre sont typiques des bâtiments qui englobent où auxquels ils s’appuient. Bien loin de paraître d’origine divine, les murs Incas semblent juste les structures les plus banales du monde, formées par des pierres qui normalement ne dépassent pas le poids qui peut être soulevé et placé par une ou deux personnes au plus. Ces pierres assez souvent ont été laissées à l’état brut, ou bien ont été grossièrement carrées, avant d’être incorporées tant bien que mal avec d’autres pierres semblables, souvent sans l’utilisation d’aucun type de mortier. Des murs de ce genre, qui se rencontrent très facilement dans tous les âges et dans toutes les régions du monde (y compris dans les champs et les jardins de l’Occident moderne) cohabitent avec des structures mégalithiques polygonales gigantesques, formées par des pierres de granit travaillées d’une façon très fine. Ces polygones atteignent un poids qui dans certains cas est estimé à 400 tonnes et avec un nombre de bien quinze angles (mais il y a ceux qui prétendent en avoir vu un qui atteint l’incroyable record de 32).
Bien que ces polygones aient été couplés avec des tolérances de l’ordre de quelques millimètres, l’entreprise de mettre en place ces murs aurait été vraiment gigantesque. Par contre, comme nous le savons tous, les couplages atteignent une telle précision qu’il est impossible d’insérer une lame même mince dans les interstices (jusqu’à présent personne n’a été en mesure d’établir à la satisfaction le degré de tolérance avec laquelle à l’origine ont été réalisés les encastrements ; mais il faut dire qu’il y a des cas où on a difficulté à discerner le point de jonction de la roche vive au moins à l’œil nu).
5. En outre, ces pierres montrent qu’elles ont été fixées entre elles au moyen d’un système de « clavettes » tout à fait semblable à celui qui a été relevé dans l’Ancienne Égypte, dont nous pouvons observer deux exemples dans les photos ci-dessous (dans la photo à gauche on peut voir une clavette dans laquelle on a trouvé un résidu du métal qu’on y a coulé)


Ceci est un détail de construction qui ajoute des difficultés de traitement de type métallurgique aux difficultés déjà énormes et au moins pour nous presque inimaginables au sujet du traitement et du placement de la pierre. En regardant ces photos il semble tout à fait clair que les polygones d’abord ont été encastrés parfaitement. Seulement à ce moment on y creusait la rainure dans laquelle finalement on coulait le métal liquide, qui communément on pense qu’il était du cuivre ou du bronze. Cela suppose que ces gens étaient capables de liquéfier le métal avec des fours qui pouvaient être déplacés dans les points du chantier où au fur et à mesure on devait couler le métal, des points qui dans un endroit comme Sacsaywaman sont éloignés même des centaines de mètres. Ou bien on doit penser qu’ils avaient à disposition des creusets capables de garder le métal à l’état liquide même après beaucoup de temps après qu’on l’avait retiré du four.
6. Cet ensemble de difficultés techniques a poussé de nombreux historiens et archéologues indépendants à conclure que entre ces structures et les constructions Incas inévitablement doit y avoir une nette discontinuité soit chronologique que culturelle. Et cette observation semble parfaitement raisonnable ou même tout à fait évidente. Tellement évidente que, si ce n’était à cause de l’opposition qui trouve dans l’histoire et l’archéologie officielles, on ne perdrait pas de temps pour en discuter. Pour établir un parallèle compréhensible : si un touriste voit dans le milieu de la savane africaine une carcasse d’une jeep réutilisée par une tribu « primitive » comme poulailler, il ne va certainement pas à attribuer la construction de la voiture aux mêmes personnes qui l’utilisent comme poulailler. Mais alors que nous savons très bien qui a construit la jeep (et nous avons aussi une idée de l’appareil technique nécessaire pour la construire), dans le cas des structures cyclopéennes de l’Amérique du sud il ne semble pas que soit restée trace aucune de la culture ou des cultures qui les ont construites. Tout ce que nous savons c’est que par rapport aux structures cyclopéennes les murs Incas semblent précisément ceux d’un poulailler. Cela a conduit nombreux chercheurs à penser que non seulement la culture qui les a construites est différente, mais qu’elle est énormément plus ancienne que celles qui habituellement sont appelées « précolombiennes ». Mais il n’est pas clair pour personne à quelle distance de temps on peut ou on doit pousser cette datation.
D’autre part, les images que nous pouvons voir ci-dessous, prises en Macchu Picchu, Ollantaytambo et Cuzco, semblent ne laisser aucune place au doute. Vraiment la question est de savoir comment on peut raisonnablement croire que les constructeurs des murs qui se superposent aux murs inférieurs et/ou les englobent peuvent être les mêmes qui ont construit ces derniers. Ou bien que leurs connaissances générales concernant le travail de la pierre – et donc leur science, leurs mathématiques, leur technique, leurs instruments et normes de travail, pas moins que l’esprit, le sens qu’ils donnaient à leurs bâtiments – puissent avoir les mêmes racines




Bien sûr, dans des domaines tels que l’histoire et l’esthétique on ne peut rien imposer à personne, même l’évidence. C’est pourquoi l’archéologie officielle – en base de l’autorité morale qui sans aucun autre fondement découle du caractère officiel de ses affirmations – soutient tranquillement que, par exemple, ce gigantesque bloc de granit rose de Ollantaytambo, que l’on peut voir dans la première rangée de photos à droite, pesant plusieurs dizaines de tonnes, travaillé de manière très fine, a été mis en place par les mêmes personnes qui l’ont utilisé pour y appuyer d’une façon approximative des pierres brutes ou travaillées tant bien que mal. Et ça ne vaut pas grande chose objecter que même le premier chroniqueur arrivé à Sacsaywaman après la conquête espagnole, Garcilaso de Vega, ne pouvait pas comprendre comment ces pierres pouvaient avoir été mises ensemble sans l’aide du diable. Encore moins ça aurait de l’importance de souligner qu’il n’y a aucun sens – ni architectonique ni encore moins esthétique – construire des fondations colossales qui apparaissent presque inhumaines pour après les utiliser pour des constructions tout à fait communes et banales, dont un retraité en bonne forme physique peut construire une imitation dans son jardin. Autant vaudrait que l’on mette un moteur d’une Ferrari dans le châssis d’un side-car, on pourrait dire. Mais la culture académique, dans des cas comme celui-ci, a tendance à abandonner le bon sens commun pour sauvegarder son propre sens historique-archéologique. Par conséquent, dans les universités à travers le monde, les professeurs d’archéologie répètent, avec le ton de celui qui a Dieu de son côté, que les Incas sont les auteurs des deux structures.
7. D’autre part – en dépit de l’obstination avec laquelle une certaine classe « officielle » continue sa défense de la thèse que les murs polygonaux comme ceux de Macchu Picchu ou de Ollantaytambo sont l’œuvre des Incas – depuis un certain temps a été créé un courant herméneutique de plus en plus répandu et majoritaire qui, contre un certain genre de cécité académique, dans la différence qualitative et stylistique des structures reconnaît une claire et distincte stratification culturelle et chronologique. Ce courant sans aucune hésitation attribue les murs polygonaux mégalithiques à une civilisation qui existait avant celle des Incas – même si, bien sûr, il est difficile de s’entendre sur la nature de cette civilisation et sur le moment de sa naissance et sa disparition. En fait, la seule structure qui a fourni un point d’appui à une tentative de datation est celle de Tiahuanaco. Ici, au moyen de l’archéoastronomie, on est arrivé à penser que cette ville avait été construite autour de 13.000 av. J.C., parce qu’on a découvert que l’alignement du temple aux solstices – qui aujourd’hui est, bien que légèrement, inexact – était juste à ce moment du cycle de précession.
On est arrivé à cette hypothèse parce que, comme nous l’avons vu abondamment dans les parties précédentes de ce travail, l’angle d’inclinaison du pôle terrestre par rapport à celui de l’écliptique oscille dans les millénaires entre le 21°,5 et le 23°,5. Et cette oscillation a évidemment un effet aussi sur l’angle qui est entre les deux solstices opposés. Pour cela, si nous imaginons que le temple de Tiahuanaco a été construit autour de 13.000 av. J.C., l’alignement du temple aurait été parfait. Ce fait a conduit à l’hypothèse que sa construction a été effectuée à ce moment-là, parce que vraiment il est difficile de penser que les constructeurs ont commis et accepté une erreur de ce genre. En fait, de ce que nous pouvons comprendre soit par les restes archéologiques que par la tradition mythique, pour ces gens l’alignement aux solstices n’était pas une banale décoration esthétique, mais un élément rituel-religieux très important, peut-être le plus important de tous. Aligner le temple du Soleil signifiait lier sacramentalement la ville et le peuple avec la divinité protectrice, lui rendre hommage, la glorifier, se conformer à sa volonté toute-puissante. Une erreur dans l’alignement devait donc être comprise comme une sorte de sacrilège : comment peut-on penser que les constructeurs l’on fait passer comme un défaut quelconque, surtout après avoir couplé la pierre de telle manière qu’il est impossible y faire passer un cheveu ? Mais en dehors de ces considérations d’ordre culturel, placer Tiahuanaco en 13.000 av. J.C. a pour soi le fait qu’il rend possible de penser que la mystérieuse culture qui a érigé les murs cyclopéens a déjà disparu plusieurs millénaires avant les Olmèques, la civilisation qui est censée être à l’origine de toutes les cultures précolombiennes que nous connaissons. Un fait de ce genre justifierait parfaitement que les Incas ne savaient rien des constructeurs des murs cyclopéens au moment où ils ont été interrogés par les Espagnols. Cela pourrait nous pousser encore à penser que les Olmèques non plus n’en savaient quelque chose, eux qui sont estimés d’être à la base de cette tradition mythique qui les voulait construits par les dieux dans les temps anciens. Une interprétation qui ne devrait pas surprendre personne, si même Garcilaso de Vega – qui selon la théorie évolutionniste appartenait à une culture beaucoup plus avancée que celle des Incas – ne sachant mieux faire, a attribuée telle construction définitivement au diable. Qui est une créature maligne, mais de toute façon douée de pouvoirs magiques.
8. Cette association au divin des structures cyclopéennes, commune tant aux Incas qu’aux envahisseurs européens, nous fait soupçonner que la mystérieuse culture qui les a construit, en dépit d’être tellement ancienne d’avoir été totalement oubliée, devait être de toute manière techniquement et scientifiquement beaucoup plus avancée – au moins dans certains traits – que celle de ceux qui sont sentis obligés à attribuer leur paternité aux dieux. Ce serait une nouvelle confirmation que l’évolution ne procède pas selon une seule ligne irréversible. Au contraire, si cette datation et la nouvelle attribution résultaient exactes, ce serait une preuve que ce dogme de la religion de l’évolution que nous avons discuté ci-dessus – c’est-à-dire que l’homme a colonisé l’Amérique du sud autour de 10.000 – 15.000 av. J.C. – doit être sans faute reconsidéré. Ou mieux : que tout ce que l’on pensait de savoir quant à l’histoire et à la préhistoire et quant à la position et au destin de l’homme dans le cosmos doit être mis en doute et repensé. Et nous allons voir comment les restes archéologiques que nous allons analyser nous donneront une poussée nouvelle et peut-être décisive dans cette direction. Ce sera la preuve empirique indiscutable d’une observation qui nous va obliger à revoir nos dogmes, nos idées fixes, nos habitudes de pensée obsolètes. Des murs cyclopéens de l’Enceinte d’Alatri, si injustement laissés de côté comme un monument plutôt insignifiant d’époque romaine, nous viendra la preuve indubitable que les connaissances chimiques de ces gens se trouvaient plusieurs étapes en avant à l’égard des nôtres (au moins dans certains secteurs).
D’après les photos que nous allons montrer le lecteur pourra facilement conclure que pour ces anciens constructeurs la pierre n’était pas un matériau dur, difficile à extraire, à transformer et à transporter. Par contre, pour ces personnes la pierre était une substance familière, aussi familière, confortable et bon marché qu’est le plastique à notre époque. Et nous pourrons voir comment cette découverte peut aider à éclairer le mystère de la technique de construction utilisée pour les travaux mégalithiques de l’Ancienne Égypte et de l’Amérique précolombienne.
Enfin, nous espérons que ces découvertes vont pousser nos chimistes et nos physiciens à changer la direction de leurs recherches, de sorte qu’ils soient en mesure de comprendre et donc d’utiliser des possibilités de transformation de la matière qui sont encore complètement hors de notre portée. Il s’agit de possibilités qui peut-être seront capables de sauver notre monde d’une de ses nombreuses perspectives d’autodestruction : celle d’étouffer dans ses déchets, si brutalement similaire à celle par laquelle un organisme peut étouffer dans ses propres excréments.
TROISIÈME PARTIE : Une possible datation de l’ « Enceinte d’Alatri » basée sur la comparaison stylistique avec d’autres cultures méditerranéennes
1. Les cas dont nous avons parlé jusqu’à présent sont désormais très célèbres, assez pour être presque un lieu commun des recherches et des discussions historiques et archéologiques actuelles. Mais il y a un cas beaucoup moins célèbre, mais peut-être pas beaucoup moins important, qui en théorie devrait être d’intérêt pour les historiens et les archéologues italiens bien plus que les restes des cultures précolombiennes. Il s’agit de l’ « Enceinte supérieure d’Alatri » (« Cinta superiore d’Alatri »), au sommet de laquelle il y a maintenant une église qui s’appuie aux restes plus internes et plus élevés de l’ancienne structure mégalithique. Devant et autour d’elle il y a un jardin, adapté à parc pour enfants. En dehors de ces structures, qui sont les parties mieux conservées du complexe, il y a une enceinte plus externe d’environ quatre kilomètres de long. Même celle-ci, au moins dans certains traits, est encore en très bon état. À l’intérieur de ces limites on a construit celle que – en nous adaptant à un usage commun – nous pouvons appeler « la vielle ville ».
En Alatri, tout comme dans l’Amérique précolombienne, les restes des puissants murs cyclopéens ne sont pas finis sous un tas de débris. Au contraire, en raison de leur extraordinaire robustesse et de leur position favorable ils ont été réoccupés et réutilisés par des gens qui – on peut supposer – aussi dans des temps très anciens ignoraient absolument l’identité de ceux qui les avaient construits. À Alatri il est arrivé exactement ce qui est arrivé à Cuzco ou à Ollantaytambo. Là, après les Incas, les Espagnols aussi ont utilisé les murs anciens, parmi lesquels jusqu’à présent vivent leur vie quotidienne les descendants soit des indigènes que des conquistadores. On peut le supposer, sans n’en savoir de plus que ce rien qu’en savaient leurs ancêtres il y a désormais quatre cents ans.
2. Il est bien évident que dans un tel contexte la méthode de datation du carbone 14 n’a aucune chance d’être employée avec un minimum de fondement. Donc, faute de coups sensationnels du hasard ou de non moins sensationnels développements de la méthode de datation scientifique-quantitative, nous n’avons aucune chance de dater scientifiquement ces structures, qui semblent encore plus silencieuses et anonymes des Pyramides de Gizeh. En fait, mis à part le style des murs, les seuls signes reconnaissables de l’identité culturelle de ses constructeurs sont des symboles phalliques qui ont été gravés sur l’entrée inférieure qui, peut-être pour cela, est traditionnellement appelée « Porte de la fertilité ». Par les symboles phalliques on peut conclure avec une certaine sûreté que dans cette culture l’organe sexuel masculin a été sacralisé parce qu’il a été associé à une conception de la sexualité humaine qui la voyait intimement connexe au divin.
C’est un fait pour nous très étrange, étant donné que l’Europe occidentale de la Réforme et de la Contreréforme a placé la sexualité parmi les choses dont il est beau ne pas parler, sinon exactement comme des choses diaboliques. Par conséquent, depuis de nombreux siècles dans les espaces sacrés soit catholiques que protestants la nudité n’est tolérée pour aucune raison, à moins que ne soit pas une œuvre ancienne d’un certain intérêt historique ou touristique. Mais si l’horreur des organes génitaux apparaît comme évidente pour le sens de la pudeur éthique et religieuse de notre culture, il n’y a pas historien et archéologue qui n’ait connaissance du fait que dans d’autres cultures même très raffinées – y compris l’Ancienne Égypte, la culture païenne classique et la culture hindoue – les organes génitaux étaient considérés sacrés ou même assimilés à des divinités au sens strict. Une chose qui, une fois que l’on a abandonné nos préjugés, on peut comprendre très bien. La puissance de générer peut, en fait, être assimilée à la capacité des mortels de transcender la mort et donc aussi le temps et la caducité de la condition humaine. Un phallus en érection ou un vagin, comme ils sont les moyens de la génération, plutôt que comme une honte peuvent bien être considérés comme des symboles de la vie éternelle, destin de l’homme ; ainsi que la condition des dieux, qui par leur essence, ne connaissent pas la mort.
Donc, puisque la porte où ont été gravés les phallus est alignée avec le soleil de l’équinoxe, nous pouvons supposer que c’était une façon d’associer la capacité du phallus de féconder le vagin à celle du Soleil qui féconde la terre. Mais même si ces indications révèlent quelque chose, cependant elles restent très, très génériques. En effet, comme on sait, nous trouvons cette façon de considérer le Soleil répandue dans le monde et dans toutes les époques. Seulement dans de cas très rares le Soleil n’a pas été considéré comme divinité ou a été considéré comme une divinité féminine. Ainsi, grâce à l’interprétation de ces symboles nous n’arrivons pas à connaître quelque chose de vraiment spécifique à propos de l’identité culturelle des auteurs des murs, et rien du tout à propos de l’époque de leur construction.
3. Vu la situation, celui qui veut enquêter sur l’âge de l’Enceinte des murs d’Alatri est situé dans les mêmes conditions de ces archéologues qui n’avaient pas encore à disposition la méthode du carbone 14. Tout ce qu’on peut faire encore aujourd’hui est donc d’observer les murs et d’essayer de déterminer si leur style doit être considéré ou non homogène et continu au regard de celui des constructions qui les ont englobés ou qui se sont superposés à eux. Et cela est une tâche que l’on exécute bientôt, puisque même l’observateur le plus distrait et mal informé réalise immédiatement que les structures mégalithiques n’ont rien à voir avec celles successives, y compris celles de la période romaine qui peuvent être vues dans la région.
Mais en plus de cela, nous pouvons faire une comparaison stylistique avec des structures qui peuvent être considérées, au moins heuristiquement, d’époques proches, et dont il est légitime de supposer que peuvent avoir eu une influence sur ces constructions. De cette façon on peut espérer d’arriver à une datation qui – quoique sur une base de connaissance beaucoup moins solide du carbone 14 – peut satisfaire au moins ces paramètres stratigraphiques-stylistiques qui ont caractérisé l’archéologie jusqu’aux années soixante.
Dans une étude de ce genre il sera difficile se passer d’associer les murs d’Alatri avec les murs grecs de style mycénien, communément datés autour de 1000-1200 av. J.C. Ce sont des murs qui, tout comme ceux d’Alatri, peuvent encore être admirés en bon ou, dans certains cas, en excellent état. Comme il est évident, les murs polygonaux ne sont pas un type de structure qui peut être caractérisée dans un style bien défini, distinguable et reconnaissable à première vue, comme celui du temple de l’Ancienne Égypte par rapport à celui de l’antiquité classique païenne. Pourtant, même ce genre de construction, en celle qui peut sembler une banalité géométrique de l’ensemble du projet, a sa propre caractérisation. Les polygones particuliers montrent leur propre style – bien que sommaire – qui est différent selon les lieux et les cultures, et en s’encastrant entre eux donnent lieu à quelque chose comme un rythme caractéristique. Mais puisque, en fait, ce genre de ressemblances et de différences ne peut pas être facilement défini, il vaut mieux, pour ainsi dire, « donner la parole » aux monuments eux-mêmes et observer avec attention les photos ci-dessous


Même à première vue, il n’est pas difficile de remarquer la ressemblance frappante entre ces deux segments de murs, de telle manière que toute personne, même si elle n’est pas un spécialiste dans le domaine pourrait facilement penser que les deux photos ont été prises dans deux parties différentes
de la même structure. Au contraire, dans un cas (photo de gauche) il s’agit d’une section de l’Enceinte des murs d’Alatri, tandis que dans l’autre il s’agit des murs de Mycènes. Mais la tâche que nous nous fixions était exactement celle-ci : associer au niveau soit historique et chronologique que stylistique-culturel l’Enceinte d’Alatri avec d’autres similaires sur la base du fait que
1) elles présentent une parenté évidente de type technique et esthétique-stylistique
2) elles se retrouvent dans une position géographique compatible avec la possibilité d’influences plus ou moins réciproques
À ce point nous constatons que les murs mycéniens ou de style mycénien sont les premiers que nous devrions envisager. Par contre, quoique avec une certaine perplexité, nous devrions exclure les murs de l’Ancienne Égypte que pourtant pour d’autres raisons apparaissent au moins comparables à ceux-ci. Les polygones de l’Ancienne Égypte, en fait, ont une forme individuelle et donc causent un rythme géométrique global tout à fait différent de celui typique d’Alatri et de Mycènes. Le nombre des angles apparaît statistiquement assez inférieur (souvent sont 4, même si en des cas assez rares on arrive à 12) et la structure est beaucoup plus linéaire, de sorte qu’on en remarque l’hétérogénéité seulement dans certains points. Pour le reste ces murs apparaissent assez semblables aux murs « normaux », c’est-à-dire avec une allure à tendance orthogonale avec quelques interruptions ici et là, comme on peut voir dans les photos ci-dessous


Pour des raisons totalement différentes il est difficile de prendre en considération les murs cyclopéens de l’Amérique du sud, comme ceux de Cuzco et de Sacsaywaman, bien que dans certains points soit possible identifier une certaine parenté de type esthétique. Mais dans ce cas on hésite à associer ces constructions, parce que l’Amérique du sud est géographiquement trop lointaine pour pouvoir supposer, sans d’autres fondements, qu’elle puisse avoir échangé des influences culturelles avec un endroit comme Alatri, alors qu’une hypothèse de ce genre a été faite, et avec des très bonnes raisons, dans le cas de l’Ancienne Égypte. Nous disons cela parce que dans l’Ancienne Égypte comme en Amérique du sud on trouve des coutumes religieuses semblables, telles que la momification des cadavres, la déformation crânienne et la construction de pyramides (quoique dans un style radicalement différent). Au lieu de cela, dans le cas d’Alatri on peut identifier comme le seul point commun avec l’Amérique du sud le culte du soleil. Et cela semble vraiment un point d’appui trop vague pour suggérer une influence réciproque.
4. En plus de la Grèce mycénienne, aussi à Malte, Tyr, Hattusa et dans d’autres sites du bassin méditerranéen, on peut observer des murs qui montrent d’avoir avec Alatri et Mycènes un système de ce que Ludwig Wittgenstein aurait peut-être appelé « ressemblances familiales » (la photo ci-dessous est du temple de Gozo)

C’est précisément pour cette raison que, au moins à première vue, on voudrait prendre en considération aussi ces restes pour notre recherche à laquelle ils ajouteraient un autre élément de charme et d’intérêt. En particulier, l’association avec le style mycénien des temples maltaises pourrait faire antidater l’origine de cette technique particulière de construction d’au moins deux mille ans. Cependant, quand on cesse d’observer ces monuments de façon, pour ainsi dire, « panoramique » et on essaie de voir plus en détail, il devient difficile de déterminer si la qualité de l’exécution et celles des accouplements est la même que celle d’Alatri et de Mycènes. Des murs comme ceux du temple de Ggantija – juste comme exemple – sont tellement érodés que, en des points, on peut en toute tranquillité faire passer la main à travers le mur. Dans ce cas, pour arriver à des conclusions raisonnablement certaines, il faudrait faire une enquête approfondie sur place pour se rendre compte s’il y a des joints en bon état. Et, s’il y en a, vérifier si leur qualité est comparable à celle des murs d’Alatri.
À regarder de plus près, même les joints de l’Enceinte d’Alatri dans certains endroits à première vue peuvent sembler bruts et approximatifs, puisque dans la part plus externe les joints sont parfois très endommagés. Ainsi, on peut avoir l’impression que les blocs sont séparés par des fissures de plusieurs millimètres, voire de plusieurs centimètres d’épaisseur. Mais c’est juste une apparence très trompeuse. Si simplement on observe avec attention on remarque immédiatement que les faces des polygones sont accouplées avec une précision qui ne peut être définie que simplement extrême. Dans certains cas, même avec un objectif 10x il est difficile de distinguer la ligne de jointure.
Dans les photos ci-dessous nous mettons un accouplement de l’Ancienne Égypte à côté d’un d’Alatri. Nous pouvons assurer le lecteur que, sauf pour les défauts externes que l’on doit à une plus grande érosion, les murs d’Alatri n’ont rien à envier à ceux de l’Osireion ou de la Chambre du Roi ou à d’autres chefs-d’œuvre justement célèbres de l’architecture de l’Ancienne Égypte. Les murs d’Alatri sont ceux de la photo de droite et nous avons indiqué avec une flèche le point où la jointure est encore parfaitement intacte. Dans les deux cas il faut noter qu’il est très difficile de distinguer le point de jointure de la roche vive (plus tard nous allons montres d’autres images pour corroborer ultérieurement la validité de la comparaison)


Donc à Alatri le défaut externe – si pourtant il est vérifiable – ne semble pas la conséquence de la mauvaise qualité de la construction, mais, plutôt, de l’exposition séculaire aux processus d’érosion de toutes sortes. Ces processus ont manifestement agi d’une façon plus visible juste à proximité de la part externe de jointures, qui sont le point faible de cette structure, pourtant très robuste, qui a été réalisée avec un calcaire qui semble de bonne qualité.
5. Donc, les murs d’Alatri, analysés avec la « vieille » méthode de l’attribution stylistique, apparaissent des œuvres d’influence mycénienne, situées dans une époque qui devait être à peu près entre 1200 et 800 av. J.C. Mais, en dépit de celle qui semble une évidence irréfutable, on a formé une tradition herméneutique consolidée – qui au fil du temps est devenue l’un des nombreux dogmes mineurs dont est parsemée la moderne théologie archéologique-évolutionniste – qui considère l’Enceinte d’Alatri comme un ouvrage construit par les Romains. Par conséquent, nous avons des datations qui la placent dans le premier ou le second siècle av. J.C. Pas étonnant du tout que cette tradition n’a pas été formée à partir de l’observation et de la comparaison des styles et des techniques de construction dans le bassin méditerranéen, mais plutôt de l’interprétation de certains écrits de l’époque romaine, qui par des nombreux auteurs sont jugés plutôt obscurs et de douteuse interprétation.
Bien sûr, personne ne veut mettre au pilori les écrivains et les écrits anciens ou ceux qui les étudient et les interprètent. Encore moins on veut refuser l’aide qu’ils peuvent nous offrir dans la reconstruction des événements qui se sont produits dans le passé. Ce que nous voulons souligner c’est plutôt une délicate question de méthode à propos de l’utilisation de ces sources dans la datation d’un monument comme celui d’Alatri. Une question qui est très similaire à celle que nous avons abordé au début quant à l’utilisation de la cartouche de Khéops pour l’attribution et la datation de la Grande Pyramide.
Supposons que dans les alentours d’Alatri il y avait un auteur romain qui dans un écrit parfaitement conservé affirme d’une manière qui ne donne lieu à aucune incertitude que l’Enceinte a été construite, par exemple, par un éminent patricien son parent. Dans ce cas aussi nous n’aurions pas seulement le droit mais aussi et surtout le devoir de douter de la véracité de la déclaration. En fait, il semble désormais établi que les Romains depuis le cinquième siècle av. J.C. préféraient des méthodes de construction différentes des murs polygonaux. Ces constructions par contre semblent appartenir à une culture, un style et une technique qui, pour ce que nous en savons jusqu’à présent, ne semblent du tout typiques ni des Romains ni du monde païen, vaste et varié, qui s’était formé dans le bassin méditerranéen à partir de la fin du Moyen Âge hellénique (soit environ le 600 av. J.C., le temps de la première version écrite de l’Iliade et de l’Odyssée).
Il faut se rappeler que même les Grecs classiques, tout comme les Incas, on construit une partie de leurs monuments les plus célèbres en les appuyant au restes colossaux de l’architecture cyclopéenne – ou en les englobant – restes que nous attribuions à la civilisation mycénienne. Le problème est que ces restes par les Grecs n’étaient pas du tout considérés comme nous les considérons, c’est-à-dire comme « restes de l’architecture mycénienne », parce qu’ils ne considéraient pas l’histoire comme une succession de cultures et donc aussi de techniques de construction destinées à naître et à passer le long d’une ligne évolutive unique et irréversible. Encore moins ils pensaient que quelques siècles avant les guerres médiques avait existé sur leur terre une « culture mycénienne ». Au contraire – comme il peut être vu aussi de la lecture d’Hérodote – les Grecs classiques pensaient qu’à cette époque le monde était peuplé par des êtres divins, les Géants de Thrace. Donc, il est logique que Pausanias, un auteur du deuxième siècle av. J.C., se référant à l’Enceinte de Tyr, écrivait dans le ton de celui qui parle d’un fait tout à fait évident
Le mur, et tout ce qui reste des ruines de la ville, est l’œuvre des Cyclopes : il est construit avec des pierres si grandes qu’un joug de mules ne serait pas capable de déplacer même la plus petite d’entre elles.
Le contenu et le ton de ces phrases rappellent immédiatement les réflexions de Garcilaso de Vega et, surtout, la manière dont les Incas répondirent aux questions des conquistadores à propos des murs de Sacsaywaman. Et en partant de cela nous pouvons déduire avec certitude l’une des raisons pour lesquelles tant dans l’Amérique du sud précolombienne comme dans la Grèce classique on a décidé de construire sur les ruines des inexplicables colosses. En raison de la divinité ou de la sémidivinité qu’on attribuait à leurs constructeurs, les restes cyclopéens et les lieux où ils se trouvaient étaient considérés comme sacrés, c’est-à-dire proches des dieux. D’autre part, on note que – à l’exception de celle d’Alatri – des nombreuses et importantes structures sacrées du Latium ont été construites sur les ruines de ces murs. Il suffit de penser à la célèbre abbaye de Cassino, que repose sur des restes de murs une part de ses fondations, tout comme autrefois faisait le temple romain qui a été remplacé par l’abbaye.
6. En fait, celui qui compare les restes des murs mycéniens datant de 1200-1400 av. J.C. avec les édifices qui de différentes manières y ont été appuyés à des dates postérieures, se rend compte immédiatement comment entre ces structures il y a une discontinuité de style qui semble radicale. C’est un peu ce qui se passe dans le présent quand on place à côté un meuble d’époque restauré et un meuble moderne en formica ou en métal poli. L’effet esthétique peut aussi être très convaincant et à sa façon harmonique, mais il s’agit d’une harmonie qui résulte d’un contraste. C’est aussi le cas des murs polygonaux qui peuvent être admirés à Delphi, qui – nous notons en passant – ressemblent de manière très évidente à ceux de l’Enceinte d’Alatri.
Par contre, les constructions typiques de la culture qui s’est développée en Grèce à partir du sixième-septième siècle av. J.C. ne ressemblent pas, même de loin, à ces restes sur lesquels elles ont été appuyées, comme l’on peut clairement voir dans l’image ci-dessous. La régularité et la parfaite symétrie des colonnades, des architraves, des murs et des escaliers de la Grèce classique sont en plein contraste avec l’hétérogénéité radicale des différents éléments des murs cyclopéens, où il n’y a une seule pièce égale à l’autre, et où des pierres énormes sont encastrées avec des pierres relativement petites

Bien sûr, personne ne songerait à nier que cette incorporation a été faite de façon vraiment excellente et qu’elle a donné lieu à un résultat esthétique tout à fait extraordinaire. Par contre, une image comme celle ci-dessus nous montre que les Grecs classiques ont su construire leurs édifices sacrés d’une manière qui est en harmonie à la fois avec le paysage et avec les ruines qu’ils ont utilisées comme fondations. Mais, de toute façon, nous ne pouvons pas nous empêcher de remarquer une très claire discontinuité stylistique, qui suggère que la vision du monde de ceux qui ont imaginé ces différentes structures était profondément différente. Le symbole architectural ne semble pas exprimer le même sentiment de la vie ou, comme on dit parfois avec un terme plus philosophique, la même Weltanschauung.
Par conséquent, même si un historien grec avait attribué les restes de Tyr au génie d’un architecte de son temps (et peut-être « à la manière du siècle des lumières » s’était moqué de ceux qui les attribuaient aux Cyclopes), précisément pour cette raison un historien actuel – étant même trop à l’aise dans une telle modernité – aurait le devoir de douter de cette nouvelle. En fait, les différents styles de la construction qui sert de fondation et de celle qu’y repose montrent une stratification et donc inévitablement aussi une distance culturelle. Des différentes idées quant à l’espace sacré correspondent inévitablement à des différentes idées de la vie, qui trouvent une expression profonde et décisive aussi bien dans les différents styles architecturaux et artistiques que dans l’éthique et dans les dogmes religieux ou dans les systèmes métaphysiques.
Le même raisonnement s’applique au cas que nous sommes en train de traiter. Même en supposant que le passage de Vitruve et la plaque de l’acropole de Tolentino – qui sont les documents écrits sur lesquels fondamentalement se base l’attribution de l’Enceinte d’Alatri aux Romains – ont été interprétés d’une façon absolument correcte, nous aurions également le devoir de douter de leur véracité. Cela parce qu’aucune source historique ou d’autre genre ne peut être jugée fiable indépendamment de son contenu. Et tous peuvent voir que l’attribution des murs d’Alatri aux architectes romains est en manifeste conflit avec ce que dans l’ensemble nous savons et pouvons encore observer quant à l’histoire et à l’architecture païenne classique en général et romaine en particulier (entre autres, les Romains étaient particulièrement attentifs à la technique quand elle pouvait être utile à la guerre : on ne comprend pas pourquoi, puisque ils étaient à mesure de construire des fortifications si puissantes dans un temps relativement bref, n’ont pas appliqué cette technique en d’autres endroits sauf en Alatri).
Une autre attribution traditionnelle de l’Enceinte d’Alatri (même si en ce moment elle n’est pas particulièrement en vogue) est celle qui veut qu’elle a été érigée par les Pélasges, un peuple dont l’existence du point de vue historique ne semble pas beaucoup plus établie que celle des Géants de la Thrace. Aux Πελασγοι se réfèrent des anciens auteurs grecs, comme Hécatée, Hérodote, Thucydide, et apparemment ils étaient déjà connus par Homère. Â ce qu’il paraît, avec ce nom on se réfère génériquement aux habitants de la Grèce en époque mycénienne et ils sont donc considérés comme des Grecs indigènes. Par contre, les historiens modernes placent leurs origines en Anatolie vers le XIIe siècle av. J.C. Les Pélasges sont décrits comme un peuple de culture génériquement hittite, qui aurait avancé vers l’ouest et enfin aurait atteint Alatri. Cette attribution, même si presque complètement sans fondement du point de vue historique, en dépit de cela semble sans doute plus raisonnable que l’attribution des murs aux Romains. Au moins, elle permet de se faire une raison de quelque manière de la parenté entre le style et la technique qui ont été utilisés à Alatri et dans d’autres sites de l’Italie centrale et de la Grèce mycénienne.
Selon la version la plus commune les Pélasges, passant de l’Anatolie à l’ouest, auraient pu de cette manière entrer en contact avec la culture mycénienne et absorber son style architectonique et son esprit religieux. Bien que l’on pourrait penser que, au contraire, ce sont les Pélasges qui ont influencé les anciens peuples de la Grèce préclassique ou que les différentes cultures ont été profondément changées par le contact mutuel.
Mais, bien sûr, avec des arguments de ce genre nous sommes toujours dans le domaine du jeu des pures hypothèses. Et le peu qu’un jeu de ce genre puisse clarifier les idées nous le découvrons en essayant de faire une rapide expérience mentale. Supposons que nous appelons ce peuple au lieu de « Pélasges », « le peuple x ». En outre, supposons de définir « x » de toute autre manière que par la simple attribution d’un nom.[1] Privés de cet instrument, même trop pratique, de définition nous nous rendons compte que de ces gens nous ne connaissons ni les institutions politico-religieuses, ni leurs coutumes, ni leurs connaissances pratiques et technico-scientifiques. En outre, nous nous rendons compte que nous ne savons même pas quoi que ce soit quant au véritable lieu de provenance de ces conquérants ou colonisateurs. Est-ce qu’ils venaient vraiment de l’Anatolie ou leur migration a commencé encore plus à l’est ? Que savons-nous des influences qu’ils pourraient avoir reçu – et donné – pendant leur (lente ?) migration de l’Anatolie vers l’Italie centrale ?
[1] En effet, phagocytés par l’idée très occidentale que connaître une chose signifie connaître son nom, certains explorateurs occidentaux ont pris pour noms des expressions indigènes qui ne l’étaient pas du tout. Par exemple, quand un espagnol a demandé au guide quel était le nom de la belle vallée qui s’ouvrait devant ses yeux, le guide a répondu : « Yucatán » : une expression que dans sa langue signifie : « sans nom ». Ou, quand un anglais a demandé à un aborigène australien quel était le nom de cet animal très étrange avec une énorme queue, qui semblait se déplacer seulement en sautant, l’aborigène a répondu : « Kan-ga-roo » : une expression qui signifie plus ou moins « je ne sais pas ».
QUATRIÈME PARTIE : Deux découvertes archéologiques qui permettent de supposer la dérivation de l’Enceinte d’Alatri de la culture de l’Ancienne Égypte
1. Cette situation de totale obscurité quant à l’origine de l’Enceinte d’Alatri a récemment trouvée une possibilité de progrès, en première instance à l’égard de la technique utilisée dans le traitement de la pierre. Comme nous l’avons déjà vu ci-dessus, si on observe les encastrements au niveau des points où ils sont encore intacts, à peine on réussit à voir une mince ligne qui sépare les pierres polygonales (qui arrivent à avoir jusqu’à quinze côtés, même si généralement ils sont « seulement » 8-10). En dépit de cela, on peut noter que la ligne de jointure est presque toujours discontinue et dans certains endroits presque incroyablement tourmentée, comme on peut bien voir dans les photos ci-dessous (mais nous pourrions en montrer beaucoup d’autres). En particulier, la jointure de la photo à droite est si mince que, nonobstant l’utilisation d’une lentille x10, nous avons dû accentuer le contour avec une ligne rouge parce que sinon on ne pourrait pas la distinguer.


Un profil de jonction tellement dentelé rend absolument impossible de supposer que pour élaborer l’encastrement ont été utilisées des machines-outils similaires à la fraise et à la rectifieuse, machines qu’aujourd’hui sont utilisées pour les travaux de haute et très haute précision (sur des matériaux qui cependant sont presque toujours des métaux) pour obtenir des surfaces planes ou cylindriques couplées avec un degré de précision similaire à celui qu’on rencontre à Alatri (qui semble être de l’ordre d’un centième-millième de millimètre, bien que dans certains points semble être – incroyablement – encore plus bas).
2. Pourtant, comme on peut le voir assez bien dans les photos, même suivant des lignes si compliquées, la précision de l’accouplement reste la même que l’on retrouve où il apparaît plus régulier. En dehors de cela, on peut observer des nombreux points de l’Enceinte où, évidemment, la pierre supérieure « pénètre » dans celle inférieure. Comme si d’une façon mystérieuse s’était apparentée avec elle. Dans les photos ci-dessous nous montrons quelques exemples, mais le lecteur curieux peut aller sur You Tube et voir les vidéos de Gabriele Venturi sur Alatri et de cette façon il pourra en découvrir beaucoup d’autres (et d’autres encore il en pourra découvrir s’il va visiter Alatri et donner un coup d’œil personnellement : chose très utile entre autres, parce que jamais comme dans ce cas est vrai l’adage « voir c’est croire ».




Il est difficile avec une photo de rendre le travail d’observation fait sur place, mais de toute façon, même ainsi on peut clairement voir que dans les points indiqués par les flèches on ne note aucune ligne de jonction entre la pierre supérieure et celle inférieure. Ces points et beaucoup d’autres points des murs font donc pencher vers une hypothèse que, si on part de notre chimie, est au moins pour le moment tout à fait impensable : c’est-à-dire que les pierres d’Alatri ont été formées et placées à l’état pâteux (ou à l’état liquide). La pâte des pierres supérieures, au moment où elle était modelée sur la forme de celles inférieures, étant dans un état chimiquement actif, devrait avoir été en mesure de dissoudre la pierre inférieure, peut-être pas encore complètement solidifiée, et s’apparenter avec elle.
Cela sur le moment peut sembler une découverte inattendue ou même choquante. Mais en dernière analyse il s’agit d’une confirmation empirique d’une hypothèse que presque nécessairement devait surgir de l’observation de la conformation des polygones et de la précision des accouplements. Tout compte fait, il n’y a et il n’y avait d’autre explication possible des encastrements qui se trouvent à Alatri si ce n’est une chimie avant la chimie : une chimie qui a atteint des résultats qui pour notre chimie sont à l’heure actuelle totalement inimaginables. D’autres hypothèses actuellement pour diverses raisons ne sont pas fiables, y compris celles qui partent de la technique la plus avancée de modelage. Supposons en fait que nos ingénieurs, à la place de la pierre, avaient à faire avec des matériaux qu’on peut facilement travailler. Même ainsi, ils n’auraient pas à disposition des machines en mesure d’accoupler des surfaces irrégulières ou même découpées de manière à les faire coïncider parfaitement sur une superficie qui, rappelons-le, est dans certains cas de plusieurs mètres carrés. Quant au travail à la main, pas même un maître des maîtres maçons dans une centaine d’années de travail pourrait produire un accouplement à « M » comme ceux que nous avons vu dans les photos ci-dessus.
En regardant les photos quelqu’un a réagi en disant que les pierres, après des siècles et des siècles de contact de l’une avec l’autre, se sont « naturellement » liées. Mais c’est une réaction aussi instinctive qu’infondée. Puisque l’intellect humain ne peut pas accepter une chose scientifiquement impossible, instinctivement dévie vers des « explications » typiques de la pensée magique. Dans ce cas, on a tendance à croire que deux choses deviennent la même chose s’elles sont placées en contact intime. Cette « explication » apparaît comme naïve et irréaliste et, au même temps, spontanée et inévitable. Donc, il sera bon de se rappeler que selon notre science de la nature nous ne pouvons pas supposer que deux portions de matière chimiquement inerte – comme deux pierres de calcaire à température ambiante – peuvent s’apparenter étant encastrées l’une dans l’autre. Au contraire, le temps produit inévitablement l’effet de la corrosion de la pierre juste à partir des jonctions, qui, quoique bien faites, sont évidemment les points les plus vulnérables des murs, comme en fait se constate aussi à Alatri.
3. Si on étend les recherches archéologiques des murs d’Alatri à d’autres restes similaires qui peuvent être trouvés dans la région environnante on rencontre une autre découverte qui a été faite et qui peut nous donner des indications sur un second type de technique qui a été utilisée pour la construction des murs polygonaux. En fait, à Arpino, à environ 50 km d’Alatri, parmi les restes encore en bon état d’une partie des murs récemment effondrées, a été trouvée une pierre qui porte ceux qui semblent être avec une certaine sûreté les signes d’une scie mégalithique. Nous la pouvons voir dans l’image ci-dessous

Ces traces, qui dans la photo sont montrées uniquement dans le point où elles sont plus nettes et profondes, en réalité courent sur toute la longueur de la pierre. Pratiquement, il n’y a presque aucun doute qu’elles ont été produite par un outil de coupe. Un géologue, qui est allé sur place pour donner un avis scientifique, a fait allusion à la possibilité que les incisions peuvent avoir été produites par des processus naturels d’érosion. Mais on peut penser qu’en ce cas l’allusion à des facteurs de ce genre représente plutôt une élémentaire prudence professionnelle. En fait, même à première vue, on remarque que
1) Les encoches ne concernent que la partie centrale de la pierre, dans un endroit où il y a une certaine convexité.
2) Celle-ci était l’une des faces internes du polygone, avec toute probabilité celle horizontale inférieure. Compte tenu de cela, on doit penser qu’au moins jusqu’au moment de l’effondrement elle a été protégée des agents extérieurs par l’intime contact avec la surface de la pierre avec laquelle elle était encastrée.
3) L’effondrement du mur et l’exposition totale aux agents naturels sont trop récents pour produire des incisions tellement nettes et profondes selon une inclinaison si strictement parallèle.
4) On doit considérer que la pierre après l’effondrement du mur a assumé une position oblique qui, en cas d’abondant écoulement des eaux, l’aurait poussée dans des directions différentes de celles où elle en effet a été incisée.
5) On ne comprend vraiment pas quel genre d’érosion aurait pu produire une encoche comme celle que nous sommes en mesure de montrer dans l’agrandissement ci-dessous

Ni l’eau ni le vent ni la poussière laissent des creux avec des angles vifs comme ceux qui sont indiqués par la flèche dans la photo. Au contraire, ces formes d’érosion ont tendance à arrondir les angles qu’elles trouvent. Par contre, les angles vifs sont produits par éventuels concassages causés par le gel ou par des écarts de température ou par le degré de salinité de la roche. Mais il convient de noter que ce type d’agents érosifs n’ont généralement des effets aussi réguliers que ceux que nous voyons sur la photo. Avec de recul, il serait vraiment étrange que n’importe quel agent érosif a été en mesure de produire des traits rectilignes, parallèles, et par surcroît situés à une distance presque parfaitement homogène sur une longueur qui est plus ou moins égale à celle de l’ensemble de la face de la pierre.
4. Par contre, si on exclut l’accumulation de coïncidences et de hasards tout à fait improbables et si on imagine une scie mégalithique au travail, alors il devient possible de comprendre ce qui est arrivé. Une lame droite, probablement assez mince, a été manœuvrée en avant et en arrière dans la direction du côté plus long du bloc pendant que, au même temps, elle était poussée vers le bas, le long de la verticale du côté plus court. À un certain moment la lame aurait coupé un point où se trouve d’une part une section de roche plus tendre (formée du calcaire de l’amalgame) et de l’autre la nervure de quelques cailloux. Pour cela, la lame – en suivant le chemin plus favorable – s’est légèrement pliée, de sorte que la coupe n’a été plus parfaitement droite. La courbure qui en a résulté paraît plutôt légère, mais assez prononcée pour laisser, dans la zone centrale, ce creux dentelé que l’on peut voir sur la photo.
Les artisans, une fois qu’ils ont terminé la préparation de la pierre pour l’encastrement, probablement ont réalisé que ce n’était pas possible de récupérer le défaut provoqué par l’opération de coupe sans altérer ainsi la forme, jusqu’au point d’en rendre impossible la parfaite collimation avec les blocs voisins. Une réduction supplémentaire de sa hauteur pourrait peut-être compromettre l’exactitude de tous les autres côtés. Il se sont donc trouvés en face de trois possibilités :
1) Modifier les blocs avec qui la pièce défectueuse devait s’encastrer, de manière à ce que le défaut pouvait être éliminé sans compromettre la précision de l’encastrement
2) Écarter le bloc défectueux et en préparer un autre
3) Accepter la présence du défaut, parce que totalement négligeable ou au moins acceptable pour la qualité générale du mur.
En regardant la photo, il semble clair que les constructeurs ont opté pour la troisième possibilité, car ils doivent avoir jugé que ce défaut – en plus de n’altérer en aucune manière la résistance du mur aux forces statiques ou aux sollicitations sismiques – ne pouvait même pas le faire plus perméable à l’infiltration d’eau, étant donné que dans les zones proches du périmètre extérieur le bloc coïncidait parfaitement avec le voisin. Cela était suffisant pour protéger les surfaces intérieures du mur de l’action d’agents externes.
5. Que les traces que l’on peut relever sur la pierre d’Arpino soient des traces d’une scie mégalithique nous le pouvons encore déduire en les comparant avec celles qui peuvent être vues dans les alentours de Gizeh ou dans les carrières d’Assouan ou dans tous ces lieux où les artisans de l’Ancienne Égypte ont laissé des traces visibles de la façon dont ils ont travaillé la pierre. La plaque que l’on voit sur la pierre ci-dessous, trouvée parmi les restes du dallage de basalte de la Grande Pyramide, montre des signes d’usure qui sont universellement interprétés comme une trace de l’opération avec laquelle elle a été coupée. Et il n’y a aucun doute que ces signes présentent une ressemblance tout à fait caractéristique avec ceux identifiés sur la pierre trouvée à Arpino. Une ressemblance qui arrive jusqu’au rythme de la scie qui pénètre la pierre, c’est-à-dire plus ou moins deux millimètres pour chaque « coup »

Que les signes sur la pierre de l’Ancienne Égypte semblent plus nets que en celle d’Arpino pourrait être parce que cette pierre, quoique exposée par au moins un millier d’années sans aucune défense à l’action incessante des éléments, a de son côté une dureté et une compacité beaucoup plus grandes que celles du calcaire. Par conséquent, également plus grande est la résistance à l’érosion. Nous ne pouvons oublier non plus que le climat égyptien a des écarts de température et d’humidité incomparablement moins nocifs que ceux que l’on retrouve dans le Latium. En plus de cela, nous devons nous rappeler que le dallage de basalte de Gizeh, dans les points de déconnexion ou dans les fissures créées par les tremblements de terre ou dans les lacunes laissées par les saccageurs, est resté presque toujours enterré sous le sable du désert. Et une accumulation de sable est un bon manteau de protection, car il empêche au sable transporté par le vent de travailler en guise de papier émeri la surface de la pierre, en plus de la protéger des écarts de température, même s’il semble que ses effets bénéfiques cessent quand elle est trop souvent imprégnée d’eau.
6. Cependant, ce qui est étonnamment similaire est la rapidité avec laquelle dans les deux cas les deux scies mégalithiques pénétraient la pierre. Comme désormais des nombreux grands spécialistes de cette matière l’ont noté, les anciens Égyptiens semblaient en mesure – quoique cela puisse nous sembler incroyable – de couper une roche consistante comme le basalte à un rythme de deux millimètres pour chaque course de la scie.
En descendant de fractions infinitésimales de millimètre – comme il arrive quand on coupe une pierre dure avec des lames de cuivre aidées par poussière d’émeri – les traces du travail sont complètement différentes. Et cela peut être démontré non pas par la spéculation, mais par des expériences de laboratoire reproductibles et contrôlables. Elles sont les expériences avec lesquelles Christopher Dunn a démontré sans équivoque que l’opération de coupe ou de carottage effectuée avec cuivre et émeri laisse des signes entièrement différents de ceux de Gizeh et donc aussi de ceux d’Arpino.
Il est vrai que dans les deux cas la qualité de la pierre est radicalement différente. Nous ne devons pas oublier, cependant, que dans le calcaire plutôt friable de la pierre d’Arpino est incorporée une grande quantité de cailloux de matériau qui est sans doute beaucoup plus dur. Et cette discontinuité structurelle rend les opérations de coupe, au moins de certains points de vue, assez difficiles, parce que, comme nous l’avons vu, il est probable que la scie ait tendance à se fléchir et à dévier.
7. Si l’on met à côté les deux pierres en question, l’affinité de la technique et des résultats obtenus serait encore plus indéniable


En ce qui concerne le basalte de Gizeh, il n’y a presque aucun doute qu’en aucune façon, pas même par les meilleurs moyens pratiques actuellement disponibles nous ne saurions pas répéter la performance. Par contre, nous pourrions espérer qu’il serait possible au moins de tenter l’entreprise sur une pierre de qualité plutôt inférieure, comme le grès d’Arpino. Toutefois, il ne faut pas se faire des illusions : il ne s’agit pas d’une chose évidente ou même facile. Le conglomérat de cailloux que nous pouvons voir sur la photo ci-dessus est tenu ensemble par un dépôt qui ne semble pas particulièrement résistant. Mais la lame progressivement rencontrerait des matériaux qui apparaissent d’une dureté plus grande, et que dans certains cas pourraient atteindre une dureté comparable à celle du basalte ou même à celle du granit. Et, à ce point, la difficulté d’enfoncer la lame dans la pierre augmenterait de façon exponentielle, d’autant plus si l’on pense qu’il s’agit de travailler avec une lame qui avance de deux millimètres à chaque coup sur toute la longueur de la pierre, qu’est environ d’un mètre. Ce faisant, dans certains moments on devrait pénétrer à travers de ces cailloux simultanément.
Si on regarde bien la photo on note immédiatement que au-dessus des traces de la lame, qui ont été laissées dans une section exclusivement calcaire, il y a un groupe de trois pierres, probablement beaucoup plus dures du dépôt qui les a incorporées. Ces pierres occupent une longueur d’une dizaine de centimètres, mais il y en a d’autres le long de la surface du bloc. Et il semble vraiment impossible que sur un matériau de ce genre une lame de cuivre aidée par de l’émeri puisse avancer au rythme que l’on peut relever sur la photo.
CINQUIÈME PARTIE : La possible connexion entre les techniques utilisées dans l’Ancienne Égypte et celles de la zone d’Alatri
1. Ainsi, la technique de coupe d’Arpino, à en juger par les signes laissés sur la pierre, devrait être liée avec celle dont encore à présent nous pouvons trouver des traces de différent type dans nombreux sites archéologiques égyptiens. Et cela pourrait être un signe très important d’un contact, quoique complexe et diversement médiat, entre la culture de l’Ancienne Égypte et celle de la zone d’Alatri. Cette hypothèse est renforcée d’une manière qu’on dirait décisive par le fait que même dans le calcaire de la Grande Pyramide on a trouvé des preuves d’un travail qu’a eu lieu à l’état liquide ou pâteux, même s’il s’agit de preuves peut-être moins convaincantes que celles trouvées à Alatri.
Dans les années soixante-dix du siècle dernier, le physique Klein, avec une équipe de collaborateurs, a étudié 25 échantillons du calcaire de la Grande Pyramide. Le résultat de ses études a été rendu public en 1979, lors du deuxième congrès d’égyptologie à Grenoble. L’analyse des échantillons a clairement indiqué que les pierres avaient une différente consistance, comme si chacune d’elles vienne d’une carrière différente. C’était un fait difficile à accepter au moins pour deux raisons. D’abord, parce qu’il semble irrationnel de compliquer l’organisation du transport en utilisant même 25 ( !?) carrières différentes, dont certaines peut-être très lointaines de Gizeh. Deuxièmement, parce que cela mettait en crise l’idée, aujourd’hui commune, qui soutient que le calcaire utilisé pour la construction de la Grande Pyramide venait principalement de la carrière de Tura.
À cette remarque Klein en a ajouté une autre, encore plus déconcertante. Le manque d’homogénéité du calcaire ne concernait pas seulement des pierres différentes, mais on pouvait le détecter aussi à l’intérieur de la même pierre. En fait, les échantillons examinés montraient systématiquement une plus grande densité d’un côté plutôt que du côté opposé. Et cette caractéristique était confirmée aussi par l’observation de ces pierres à l’intérieur de la structure qui sont restées exposées à l’action érosive du vent et du sable, après que depuis quelques siècles la Grande Pyramide a été privée de son revêtement de couverture de calcaire très fin. Ces pierres montrent d’avoir subi beaucoup de dégâts dans certaines parts plutôt que dans d’autres. Cela est un signe certain du manque d’homogénéité structurale, que pourtant ne semble pas explicable à partir de la qualité de la pierre ainsi que l’on peut la relever dans les carrières.
Comme on peut le voir dans la première photo ci-dessous à gauche, la partie supérieure de la pierre indiquée par la flèche est demeurée pratiquement intacte, tandis que la partie inférieure a été érodée à une profondeur qui semble même d’environ un demi-mètre (ou plus). Et l’analyse des pierres qui peuvent être vues dans les autres images donne lieu à des observations très similaires, bien que le phénomène se présente de façon moins visible. Pourtant le calcaire de la carrière de Tura ne manque pas particulièrement d’homogénéité. Au contraire, il semble apparemment d’une assez bonne qualité : il ne devrait donc pas donner lieu à des discontinuités érosives particulièrement marquées




Les résultats de Klein ont été plus tard confirmés par les recherches de Davidovits, chimiste de l’Institut géopolymérique de Paris et professeur de science archéologique appliquée aux États-Unis. Sur la base de recherches menées en 1974 par des techniciens de l’Université de Stanford il a découvert que le calcaire de la Grande Pyramide contenait une quantité d’eau largement supérieure au normal et que cette eau était inégalement répartie. Une partie était beaucoup plus élevée par rapport à l’opposée, exactement comme la densité de la pierre relevée par Klein. En outre, en analysant des échantillons de la pierre, Davidovits a trouvé des restes de cheveux et des ongles humains. La seule explication possible d’un tel fait lui a paru celle-ci : qu’ils y étaient tombés alors que la pierre était à l’état liquide ou pâteux, en y restant incorporés. Ci-dessous on peut voir une image dans laquelle ce que Davidovits a jugé un cheveu humain semble effectivement avoir été incorporé dans la pierre

Mais avant même que les preuves empiriques étaient arrivées à le démontrer d’une manière qui semble vraiment difficilement discutable, ce qui nous suggère qu’en Égypte et en Amérique du sud – ainsi que dans la région de la Méditerranée – la pierre pourrait avoir été travaillée à l’état liquide et/ou pâteux ce sont exactement les énormes problèmes techniques et logistiques que, dans le cas contraire, on devrait affronter pour construire des systèmes cyclopéens de maçonnerie. Particulièrement grave, pour ne pas dire insurmontable, semble la difficulté qui se pose au moment de la construction de polygones avec un grand nombre de côtés et au même temps celle de profils d’accouplements dentelés et tolérances très réduites. Déjà il serait difficile de construire des murs comme ceux d’Alatri avec un degré de tolérance d’un centimètre. Les construire avec un degré de tolérance inférieure au centième ou au millième de millimètre est une entreprise simplement inimaginable. Si nous analysons les problèmes techniques impliqués avec un minimum d’attention aux détails nous pouvons avoir une idée de leur énormité presque surréelle.
2. Si on s’arrête sur Alatri, objet de nos recherches sur le terrain, nous constatons que l’Enceinte des murs dans son ensemble mesure – comme cela a été dit – environ quatre kilomètres. Si on adopte des chiffres assez prudents, on peut imaginer que pour chaque kilomètre ont été utilisées environ six mille pierres pour un total de 24.000. Considérant pour chaque pierre une moyenne de 8 côtés et un périmètre moyen d’environ 3 mètres, cela signifierait que pour les 4 kilomètres de longueur totale de l’Enceinte on aurait fait environ 70 kilomètres de joints pour un total d’environ 200.000 côtés. Considérant que chaque joint a en moyenne un mètre de profondeur, cela signifierait que les surfaces couplées (que l’on se rappelle : avec une tolérance de l’ordre du millième de millimètre ou inférieure) seraient égales à 70.000 mètres carrés. Une entreprise de ce genre semble vraiment rien de moins qu’un miracle. Celui qui connaît, quoique de façon imparfaite, la mécanique de haute précision comprend très bien pourquoi de tels travaux ont été attribués aux dieux, aux Géants de Thrace ou au démon. Pourtant, l’archéologie officielle soutient tranquillement que tout ce démesuré travail d’encastrement aurait été fait en soulevant et en descendant les blocs l’un sur l’autre, en adaptant lentement les surfaces jusqu’à les faire coïncider de cette manière parfaite que nous l’avons vu ci-dessus. Et tout ce travail en utilisant des marteaux de pierre et des ciseaux de cuivre ou au maximum de bronze.
Maintenant, comme nous pouvons tous le comprendre facilement, soulever et descendre des blocs de quelques tonnes n’est pas un problème de très facile solution, n’ayant que des technologies très arriérées. De toute façon, il est tout à fait clair qu’il ne serait pas possible de soulever et de descendre les blocs en utilisant les élingues habituelles, telles que celles dont nous voyons un exemple dans la photo ci-dessous

Cela ne pourrait pas être fait, parce que de toute évidence les élingues empêcheraient le contact entre les surfaces des pierres, ce qui à son tour empêcherait le contrôle de la précision de l’encastrement. Par conséquent, afin que le fonctionnement d’une telle méthode soit possible, on aurait deux alternatives :
1) Creuser des canaux dans la pierre afin que les élingues ne perturbent pas le contact entre les surfaces.
2) Travailler la pierre de telle manière qu’elle ait à la fois dans la part antérieure que dans celle postérieure des pivots qui s’étendent au-delà de la longueur utile pour la construction des murs. Les pivots pourraient être utilisés pour fixer les élingues et ensuite, une fois terminé le travail, pourraient être coupés et ainsi laisser au moins la part antérieure lisse et propre comme en effet on peut voir à Alatri (dans certains endroits on note, par contre, comme dans la part postérieure, c’est-à-dire celle qui donne vers l’intérieur de l’Enceinte il y a des parties brutes qui s’étendent vers une sorte de pointe).
Si on analyse les pierres restées découvertes on ne note pas la présence de canaux tels que ceux décrits au point 1). Donc, pour faire fonctionner la théorie que le travail a été fait en adaptant la pierre qui à plusieurs reprises était levée et abaissée, il ne reste qu’accepter l’hypothèse que nous avons fait au point 2). À savoir que les pierres avaient des pivots qui s’étendaient au-delà de la longueur utile, ce qui permettait de les brayer sans empêcher le contact entre les surfaces à accoupler. On peut obtenir une idée visuelle de cette méthode en observant les croquis ci-dessous
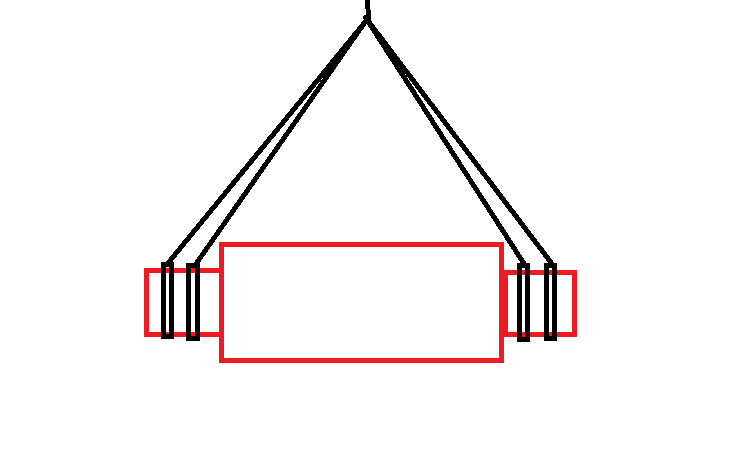
Maintenant, au moins en ce qui concerne l’Enceinte d’Alatri, cette hypothèse pourrait fonctionner assez bien, étant donné que les pierres atteignent un maximum de 30 tonnes, mais en général elles sont de taille et de poids assez plus réduits (en moyenne 3 ou 4 tonnes).
Supposons donc que les pierres pouvaient être soulevées et descendues à volonté de l’opérateur. Le problème reste, pour ce que nous en connaissons, que des encastrements avec tolérances telles que celles que peuvent être trouvées le long de l’Enceinte (soit un millième de millimètre ou même moins) même si le surfaces sont parfaitement plates (et elles ne le sont pas) peuvent être réalisées seulement avec des machines de haute précision. En plus de cela, les encastrements devraient être contrôlés avec des instruments que, pour être produits, il faudrait évidemment des machines d’un niveau encore plus haut que celles que l’on a utilisées pour faire les encastrements.
Mais celles-ci, bien sûr, dans le meilleur des cas, sont seulement des suppositions. Des suppositions qui ont une valeur heuristique très faible, voire inférieure à zéro. Nous avons bien vu que l’irrégularité des joints rend impossible l’usage de nos machines, soit de haute que de basse précision, et même celui d’instruments de contrôle, comme équerres et comparateurs, qui fonctionnent seulement et exclusivement pour le contrôle des surfaces plates ou circulaires (ou, de toute façon, régulières). Par conséquent, ces joints, outre d’être élaborés à la main, devraient être contrôlés à l’œil. Et ici il semble que se pose un problème insurmontable, puisque l’œil humain n’est pas capable de percevoir des différences de l’ordre d’un centième ou d’un millième de millimètre (ou même moins) et par surcroît sur des surfaces de deux ou trois mètres carrés. Pourtant, c’est ce que l’on devrait faire pour construire des encastrements comme ceux qu’on a à Alatri. Dans les images ci-dessus nous avons constaté que même avec un objectif x10 il est difficile de distinguer la ligne de l’accouplement. Il est évident que si on n’a pas à disposition un objectif plus puissant que celui-ci, peut-être aidé par un laser, le travail ne pourrait pas être même imaginé. D’autre part, ces instruments serviraient à contrôler le joint seulement dans sa partie extérieure. Mais comment faire pour réaliser sa qualité dans la partie intérieure, parfois plus profonde d’un mètre, qui en tout cas est entièrement inaccessible même à ces systèmes de contrôle pourtant très raffinés ?
En termes pratiques, cela signifie que même la réalisation d’un seul de ces accouplements exigerait une habilité manuelle que, suivant Garcilaso de Vega, on ne pourrait définir rien de moins que diabolique. Cela, à son tour, signifie que dans notre temps et avec nos moyens, réaliser même une dizaine de ces murs serait tout à fait impossible, en dépit d’être prêts à dépenser des millions d’euro pour l’entreprise, ainsi que, bien sûr, quelques années ou peut-être quelques décennies de travail.
3. Nous nous rendons compte que des affirmations de cette nature peuvent paraître un peu apodictiques pour le lecteur qui ne possède pas d’expériences directes dans le domaine de la mécanique de haute précision. Par contre, tout ingénieur pas moins que tout architecte – étant conscientes des problèmes liés à la création d’accouplements avec une tolérance inférieure au centième de millimètre sur un matériau « dur » comme la pierre – trouvera que le raisonnement que nous avons fait jusqu’ici est tout à fait superflu. Dès le premier moment, ce que nous pouvons appeler « l’impossibilité technique » des murs d’Alatri lui sera sauter aux yeux d’une façon immédiate et instinctive.
D’autant plus immédiate et instinctive semble donc l’impossibilité de murs comme ceux de Sacsaywaman ou d’autres similaires qu’on rencontre en Amérique du sud, où aux difficultés que nous avons déjà vu à Alatri il faut ajouter
1) que la pierre utilisée est le granit, un matériau énormément plus dur que le calcaire, qui est terriblement difficile même pour l’outillage plus avancé à notre disposition aujourd’hui
2) que le poids de chaque pierre est en moyenne plus élevé que dix ou vingt fois de celui des polygones d’Alatri, avec des pointes qui, à ce qu’il semble, peuvent atteindre 400 tonnes, mais que sur des murs comme ceux de Sacsaywaman rarement est en dessous de 10 ou 20 tonnes, avec une moyenne qui semble dépasser les 50 tonnes.
Pour donner au lecteur une idée de ce qui signifie aujourd’hui déplacer un poids de cette sorte, dans la photo ci-dessous nous montrons une grue capable de soulever un poids de l’ordre de 200 tonnes. Notez la hauteur de l’homme (indiqué par la flèche) par rapport à celle de la machine et notez que la grue ne se déplace pas sur un terrain accidenté, mais plutôt sur un sol bien préparé à cet effet

Des murs comme ceux d’Alatri ou de Sacsaywaman sont donc au moins du point de vue de notre science et de notre technique des « objets impossibles ». Et encore plus impossibles semblent les murs cyclopéens qui semblent avoir été découverts en Russie, sur le mont Shoria, où les photos nous montrent une espèce de mégalithes de granit sculptés d’une façon très fine. Dans certains endroits ces géants de pierre – qui parfois semblent dépasser les 3000 tonnes et atteindre même les 5000 – paraissent encastrés avec la même mystérieuse technique avec laquelle étaient encastrés ceux de l’Amérique du sud. Dans cette image la précision de l’encastrement semble vraiment plus ou moins la même, même s’il faut dire que, sur l’étendue de la paroi globale du mur supposé, les parties qui sont encore en bon état ne semblent pas être nombreuses


Nous pouvons immédiatement noter la taille monstrueuse de ces murs en comparant, dans la photo à gauche, les dimensions des blocs avec celles de la personne (indiquée par une flèche rouge). Le tout semble tellement disproportionné aux capacités humaines qu’immédiatement on a avancé des doutes bien compréhensibles, qui, si vraiment on le démontrerait construction humaine, pousserait la réalité bien au-delà de toute imagination.
En fait, au moins sur le moment, l’hypothèse que ces murs sont le produit d’un phénomène naturel ne semble pas particulièrement bien fondée. Le granit est une des pierres les plus consistantes et compactes qui existent sur la terre. Habituellement il ne montre pas des fissures ou des lézards et, s’il y en a, il s’agit de fissures déchiquetées : aussi loin que nous savons, personne n’a jamais vu un mur de granit qui forme un encastrement à « L » aussi parfait que ceux que nous voyons ci-dessous. Même quand il est divisé au moyen des coins, on remarque que la facture n’est jamais parfaitement droite. C’est une chose que l’on peut constater en regardant cette pierre qui a été abandonnée par les anciens Égyptiens dans les carrières d’Assouan
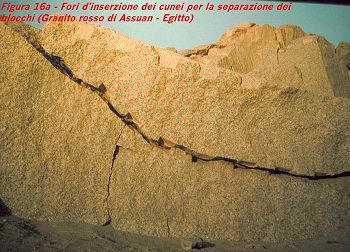
Mais, au contraire, ces blocs de pierre étonnants montrent une tendance parfaitement ou presque parfaitement perpendiculaire, comme nous pouvons clairement voir dans l’image ci-dessous






Mais même s’il s’agissait d’un phénomène naturel, il doit être question de quelque chose plutôt inhabituelle, parce que jusqu’à présent on n’avait jamais vu le granit qui ait une fissure tellement orthogonale et, au même temps, tellement « cyclopéenne » et « humaine trop humaine ». Ordinairement, lors de l’observation de phénomènes de ce genre, il s’agit d’immenses couches disposées de telle manière que les sollicitations telluriques contrastantes peuvent feindre la pierre d’une façon régulière et ainsi créer l’illusion d’un pavage fait par les humains (phénomènes qui se produisent, par exemple, dans ce qu’on appelle les pyramides de Bosnieue les signes Que les signes sur la òpierre, qui semblent effectivement un caprice de la nature). Mais dans ce cas on ne rencontre pas les conditions d’un phénomène de ce genre, étant donné que ce mur cyclopéen de la Sibérie est une espèce de dent qui sort de la terre. Cela semble qu’il le fait libre de tensions verticales qui agissent symétriquement. La photo panoramique que nous pouvons voir ci-dessous semble vraiment même trop explicite



Ces murs semblent donc effectivement œuvre d’êtres humains. Mais, puisque leur découverte est très récente, la meilleure chose est probablement suspendre le jugement et attendre que des études géologiques et archéologiques approfondies donnent des avis plus réfléchis. Le climat sibérien, caractérisé par des écarts de température très violents, probablement fait possibles des phénomènes que ailleurs sont même inimaginables. Mais, même si c’était œuvre de la nature, cette découverte serait quand même très précieuse, car elle confirme que notre connaissance est limitée et que le monde est encore capable de nous surprendre avec des événements inattendus. Qui sait, peut-être les profondeurs de la nature sont habitées par des forces dont notre science mathématisée encore ne sait rien.
4. Mais même en excluant pour le moment le mur de Shoria du domaine des monuments à prendre en considération dans cet article, le fait reste que des murs cyclopéens comme ceux que nous tous connaissons à l’ingénieur et à l’architecte du XXe siècle apparaissent comme œuvres impossibles. Toutefois, si parler d’impossibilité technique vis-à-vis d’un projet ou d’une hypothèse semble plausible et raisonnable, au contraire il ne semble pas plausible et raisonnable en parler devant des objets finis : parce qu’ils sont là, devant les yeux de tous. Par conséquent, leur réalisation est impossible pour nous. Mais, bien sûr, celui qui les a construits devait avoir à sa disposition la technologie apte pour réaliser le travail sans des difficultés plus grandes que celles que nos artisans, nos ingénieurs et nos architectes rencontrent dans la construction d’un gratte-ciel.
D’autre part, il est assez clair que la construction des murs comme ceux d’Alatri offre des difficultés d’un genre tout à fait différent que celles qu’on rencontre dans la construction d’un gratte-ciel. Donc, les outils à disposition de ces personnes devaient être différent des nôtres. Par conséquent, tenu compte de la nature du travail et des indices que nous avons trouvés, il est logique de conclure que – entre autres choses – les constructeurs d’Alatri devaient avoir à leur disposition un système qui leur permettait de liquéfier et/ou d’adoucir la pierre. De cette façon, le travail, loin d’être impossible, il a pu être encore assez simple.
Supposons en effet que les dizaines ou centaines de tonnes de granit de chacune des pierres de Sacsaywaman pourraient être effectivement réduites à l’état liquide. Ou portées à un niveau pâteux tel qu’elles peuvent être transportées chaque fois à peu de dizaines de kilos et mélangées sur place. À ce stade, entre un polygone de 4, 5, 10 tonnes ou bien de 100, 200 ou 500 tonnes il n’y aurait pas beaucoup de différence. Si le matériau pouvait être versé dans une moule – supposons – avec des récipients portatifs, le problème était juste d’avoir un peu de patience. Un peu comme cela se passerait si la même partie des murs avait été réalisée par le montage d’un grand nombre de petites pierres.
Avec cette méthode de construction on pourrait également expliquer la nature découpée, mais absolument précise, du profil des encastrements. Si on avait travaillé comme nous travaillons, cela semble une œuvre digne du diable. Mais si on travaille avec une pâte ce serait une chose triviale même réaliser ces encastrements à « M » que nous avons vus au début de la troisième partie. Ni serait plus impressionnant le nombre de côtés des polygones. La réalisation de tels polygones de 5, 8 ou 10 ou 16 côtés serait une entreprise également simple. Tout le monde peut en faire expérience en essayant de construire un mur polygonal en miniature en utilisant un matériau tel que le « Das », comme ce qu’on voit dans l’image ci-dessous

À Delphi on trouve des polygones qui sont de forme tellement irrégulière qu’il devient même difficile de définir le nombre des côtés. Nous en pouvons voir quelques exemples dans les images ci-dessous


Eh bien, avec une technique comme celle que nous venons de décrire, même les œuvres de sculpture et d’architecture, que jusqu’à présent nous aurions jugé des chefs-d’œuvre incomparables, deviendraient une entreprise bien ordinaire, encore plus facile que celle de tourner un vase de terre cuite.
5. Pour faire la scène familière, imaginons que ces murs ont été faits avec de l’argile. Tout d’abord on réalise un polygone, après on le laisse sécher au soleil. Après on réalise ceux à côté, après celui au-dessus, et on les laisse sécher à leur tour, et ainsi de suite, jusqu’à ce qu’on a terminé le mur.
Il se peut que l’argile, si elle est très douce, peut dissoudre celle des polygones, sur lesquels on l’étale, surtout si elle n’était pas encore totalement séchée. Et cela expliquerait les points de l’Enceinte d’Alatri que nous avons vus dans ce travail (et les autres publiés su You Tube), où la pierre d’éléments différents apparaît apparentée. Ce fait serait incompréhensible si elle avait été traitée et assemblée à sec, comme on l’a cru jusqu’à présent.
En outre, cette hypothèse nous explique de manière satisfaisante aussi la facilité – commune soit dans l’Ancienne Égypte qu’en Amérique du sud et aussi à Arpino – avec laquelle on pouvait scier des matériaux comme le basalte ou le granit rose, qui sont ardus même pour nos machines et nos outils les plus avancés. Si ces gens étaient vraiment en mesure d’adoucir la pierre d’une manière considérable, alors même avec des scies de cuivre sans renforcement il aurait été possible de les pénétrer en raison de deux millimètres par coup. Et ce serait aussi l’explication de certains signes que l’on trouve à Assouan, où il semble que la pierre a été traitée d’une manière similaire à celle avec laquelle on pourrait faire avec une spatule sur l’argile. Ce sont des signes communs aussi aux pierres trouvées à Puma Punku, un site archéologique situé près de Tiahuanaco. C’est un autre indice qui renforce l’hypothèse d’un lien entre la culture de l’Ancienne Égypte et celle de l’Amérique du sud précolombienne. Nous pouvons les voir dans les photos ci-dessous (les photos en noir et blanc présentent des pierres trouvées dans la zone de Tiahuanaco)






Évidemment de signes de ce genre on ne trouve pas trace dans les modernes carrières de pierre, étant donné que les outils utilisés dans les carrières procèdent en enlevant des éclats de matériau. Donc il est de toute évidence qu’ils laissent sur la pierre traitée les signes de l’écaillage. Mais dans aucune de ces photos on ne rencontre des indices que le matériau a été ébréché. Ainsi, si nous voulions obtenir des rainures de ce genre, nous ne pouvions pas en aucune façon espérer les obtenir comme des traces de traitements accidentels, mais nous devrions les sculpter exprès, comme on le fait chaque fois qu’on veut obtenir n’importe quelle forme. Ni ces traces de traitement peuvent avoir été laissées par des marteaux de dolérite, qui généralement ont une forme sphérique ou hémisphérique. Même celui montré dans la photo, qui a une forme un peu anormale et est aussi un peu plus grand que la moyenne, ne pourrait pas faire des canaux comme ceux que l’on peut voir dans les photos ci-dessus, en particulier dans le cas des pierres de l’Amérique du sud (au mois que le tailleur de pierres ne soit pas un magicien, c’est-à-dire un proche parent du diable, comme aurait dit Garcilaso de Vega). Nous plaçons à côté deux photos parce qu’on puisse avoir une idée claire de l’entreprise que l’on devrait accomplir avec des moyens tout à fait inaptes


L’angle qui est au fond de la tranchée creusée dans le granit rose d’Assouan est si aigu que pour le réaliser les artisans de l’Ancienne Égypte auraient dû laisser de côté le marteau de dégrossissage de forme sphérique ou hémisphérique pour adopter un ciseau de finissage (également en pierre, parce que – nous le rappelons – ni le cuivre ni le bronze sont à mesure de rayer le granit). Mais dans quel but ? Cela est vraiment complètement insensé. Considérant que ces signes de traitement ont été également trouvés sur le célèbre obélisque inachevé, il est impossible d’imaginer qu’ils ont été , réalisés pour obtenir une décoration, puisque la surface de l’obélisque, une fois achevée, aurait demeurée sans ornements et/ou vraisemblablement recouverte de hiéroglyphes. Donc, ces rainures ne peuvent pas être autre chose que des signes casuels de traitement, qui nous montrent d’une façon qui semble indubitable que cette pierre a été travaillée à un état pâteux.
L’égyptologie officielle à ces observations tout à fait évidentes objecte qu’en effet un grand nombre de marteaux de dolérite ont été trouvés dans les carrières d’Assouan ainsi que dans d’autres endroits où les anciens Égyptiens travaillaient la pierre. Si on utilisait des outils d’un autre genre, pourquoi ces outils ont été mis dans les carrières ?
Une réponse qui est tout à fait spontanée c’est que ces marteaux pourraient faire partie d’un rituel, où étaient offerts les outils considérés sacrés parce que très anciens et part d’une tradition vénérée. Pour donner un exemple qui peut faire compréhensible la chose pour un esprit moderne, il est arrivé presqu’à tout le monde de noter que les agents de police au cours de manifestations portent l’épée ; mais cela ne veut pas dire que, en fait, l’épée soit utilisée pendant le service réel. En ce cas, l’épée est un symbole d’une tradition à laquelle dans le présent on fait référence comme point fondamental des idéaux éthiques et civils de l’Arme, pas un outil que dans le présent est utile pour quelque chose.
Le fait est que notre culture et notre science sont désormais complètement imprégnées par un laïcisme extrémiste. Cela nous fait oublier de façon systématique des données historiques et archéologiques assez évidentes : la plus évidente de toutes est que dans l’Ancienne Égypte les constructions en pierre avaient un but seulement sacré. À partir de la matière première (la pierre), des endroits où elle était extraite pour finir par la technique avec laquelle elle était extraite et traitée. Donc, il n’y aurait rien à s’étonner si dans une carrière comme celle d’Assouan on célébrait des rituels où des outils traditionnels avaient un rôle essentiel.
C’est vrai : l’hypothèse que dans l’antiquité la pierre était traitée à l’étal liquide ou pâteux – à partir de l’étal actuel de notre physique et de notre chimie – nous semble de la science-fiction. D’autre part, même en 1930 l’énergie atomique et ses possibles applications civiles et militaires auraient pu sembler de la science-fiction presque à tout le monde, peut-être même aussi à ces experts en physique atomique qui étaient sur le point de la découvrir. Cela n’a pas empêché que seul quelques années plus tard l’énergie atomique a été découverte et que en 1945 a été utilisée pour raser au sol Hiroshima et Nagasaki.
Et de cette forme d’énergie, si ancienne mais pour nous absolument nouvelle – pour ne pas dire tout à fait révolutionnaire – nous avons trouvé une première preuve théorique, que nous avons exposée dans The Snefru Code parties 3 et 7. Donc, nous renvoyons le lecteur, qui désire avoir une idée claire de ce qu’il s’agit, à ces deux articles. Ici, très brièvement, nous pouvons dire que notre hypothèse est basée sur la découverte que la masse et le rayon classique du proton et de l’électron sont inversement contraire : leur relation est en fait 1/1836.
Nous pourrions donc supposer à titre heuristique que la masse est inversement proportionnelle à l’espace occupé par la charge électrique. De cela peut-être nous pouvons déduire que la masse (et donc le champ gravitationnel exprimé par la masse) n’est plus – pour ainsi dire – qu’énergie magnétique concentrée.
Donc, à titre d’hypothèse, si l’on pouvait concentrer l’énergie de l’électron dans un rayon équivalent à celui du proton on pourrait augmenter sa masse de façon proportionnelle. Inversement, l’expansion de l’espace occupé par la charge électrique du proton réduirait sa masse (et donc son poids) à une valeur similaire à celle de l’électron, soit 1836. De cette façon, un rocher comme la Pierre de la Lune de Baalbek – qui a un poids d’environ 1200 tonnes – pèserait 1200 = 0,653 tonnes. Les 5000 tonnes du Mont Shoria deviendraient 5000 :1836 = 2,72 tonnes, soit un poids transportable avec une relative facilité.
Et justement cela pourrait être la façon par laquelle dans l’antiquité on pouvait déplacer ces blocs de granit qui nous apparaissent monstrueux et qu’à présent nous ne serions pas capables de déplacer même en utilisant notre technique la plus évoluée. En outre, il est possible que cette opération peut créer un tel déséquilibre chimique-magnétique que des matériaux très durs peuvent être réduits à un état pâteux. Cela expliquerait l’extraordinaire facilité avec laquelle des gens comme les anciens Égyptiens pouvaient traiter des pierre comme la diorite avec la même efficacité avec laquelle nous traitons le plastique ou l’aluminium.
Ici, il semble également très important de noter que la base théorique de l’entreprise de réduire la pierre à l’état liquide ou pâteux a été chiffrée dans l’architecture sacrée de l’Égypte ancienne, parce que ce fait crée les conditions pour établir un intime lien culturel avec un temple comme celui de Alatri. Un lien dont, sur le plan géométrique, nous trouvons des indices dans les images ci-dessous
En dépit de concepts physico-mathématiques que nous avons réussi à mettre ensemble pour établir cette hypothèse, beaucoup des gens pourrons penser que, malgré tout, nous sommes dans le domaine de la science-fiction, et non de la science authentique. D’autre part, vers 1950 Ludwig Wittgenstein, dans une de ses œuvres les plus célèbres « La certitude », a porté comme exemple de fantaisie délirante – parce que selon lui radicalement en contradiction avec nos connaissances scientifiques et avec le sens commun – celui d’un homme qui croit d’avoir été ou de pouvoir aller sur la Lune. Seulement vingt ans plus tard les premiers hommes ont débarqué sur la Lune et actuellement on pense de la façon pour les faire arriver sur Mars.
6. Face à des œuvres comme celle d’Alatri nous nous trouvons encore dans des conditions similaires aux conditions où se trouverait Leonard de Vinci en face d’un bassin ordinaire et usuel en plastique : un objet pour nous tout à fait ordinaire,[1] mais que pour lui aurait des traits particulièrement énigmatiques. Certes, il comprendrait d’une façon générique les possibilités d’utilisation et la forme lui serait familière. Mais il serait totalement perplexe par le type de matériau et la méthode avec laquelle on l’a construit.
Le plastique est translucide, mais tout de suite il se serait rendu compte que ce n’est pas du verre. Au contraire du verre, une fois qu’il a été formé, il ne peut pas être facilement recyclé pour produire des objets de forme différente. Donc, si Léonard lui avait approché une flamme, il l’aurait vu brûler, mais il n’aurait pas pu le dissoudre. Même dans le cas où le plastique avait été de ce type qui en se réchauffant s’adoucit un peu, probablement il n’aurait été pas en mesure de lui donner une forme beaucoup différente de celle qu’il tend à prendre spontanément quand il se réchauffe.
Par conséquent, il est d’imaginer que Léonard de Vinci, même avec tout son génie, n’aurait pas été en mesure de comprendre comment effectivement on arrive à produire un bassin en plastique. Probablement il lui serait été aussi impossible de deviner la direction vers laquelle il aurait dû pousser ses hypothèses pour commencer le voyage que pouvait amener un homme de son temps à comprendre de quoi est fait et comment est possible former un tel objet. Compte tenu de ses tendances intellectuelles, peut-être Léonard n’aurait pas fait de commentaires sur son échec avec les mots de Garcilaso de Vega et il n’aurait pas eu recours aux arts diaboliques pour expliquer l’étrange affaire. Mais on peut imaginer qu’il serait resté bien perplexe.
Tout aussi perplexes nous nous trouvons nous aussi en face d’objets qui appartiennent à un monde culturel et scientifique qui pour nous – au moins jusqu’à présent – est presque complètement étranger et incompréhensible.
7. Pour avoir une idée de la distance non seulement technique et scientifique, mais aussi et surtout spirituelle qui nous sépare des gens comme ceux d’Alatri, nous pouvons nous déplacer dans un des sites archéologiques les plus importants du monde. Un de ces sites dans lesquels la soi-disant raison ou le soi-disant sens commun souffrent des coups de telle sorte qu’il n’y a autre défense – au moins à présent – que le refoulement, la banalisation ou, mieux encore, la parfaite indifférence.
Le site dont nous parlons est celui de Nabta Playa, qu’on devrait placer dans ce qu’on pourrait appeler la préhistoire de l’Ancienne Égypte, étant donné que le carbone 14 le « voit » fréquenté entre 5000 et 7000 av. J.C. Au niveau strictement architectural, tout ce qu’on peut voir aujourd’hui est un cercle mégalithique de dimensions plutôt réduites avec des pierres qui ne semblent pas avoir reçu un traitement digne de mention (bien qu’il faut penser qu’elles ont subi une corrosion très grave, et donc qu’il n’est pas facile d’imaginer ce qui était leur degré original d’élaboration). Nous pouvons voir ce qu’en reste dans la photo ci-dessous
[1] Cependant il faut noter que sa banalité n’empêche pas le fait que très peu de ses utilisateurs n’ont pas la moindre idée de comment en effet il est construit, des technologies et des sciences et du genre d’organisation industrielle qui sont nécessaires pour le construire. Si après on considère le portable, y compris celui qu’on offre à 20 €, la situation devient illisible pour tous, sauf peut-être pour une poignée d’experts qui – il est à jurer – en dépit d’avoir des idées assez claires, ne sont pas en mesure de reconstruire chaque étape de son fonctionnement et de sa production. Ces sont des notions maintenant si complexes qu’elles ne peuvent plus se trouver dans la tête d’un seul individu : c’est le système que dans son ensemble les possède. Et le système est au même temps l’entité plus abstraite et plus concrète que l’on peut imaginer. Abstraite, parce qu’elle est insaisissable. Concrète, parce qu’elle produit tout ce dont nous avons besoin sans que personne puisse comprendre comment elle le fait.

Par comparaison, un site comme Stonehenge nous paraît beaucoup plus sophistiqué et « avancé », au moins en raison du poids énormément supérieur des pierres utilisées et de leur disposition en trilithes, ce qui est évidemment beaucoup plus difficile des simples menhirs de Nabta Playa. Pourtant, ce site présente des caractéristiques géométriques qui en effet sont tout à fait extraordinaires. Quant à sa relation avec le nombre d’or, nous avons déjà analysé en détail certains problèmes en The Snefru Code partie 5. Mais plus tard nous avons découvert que cette structure semble avoir aussi une relation avec la constante d’Euler « e », égale à 2,71828… En effet, l’angle formé entre l’axe nord-sud et celle du solstice d’été est compris entre 69° et 70°. Alors, l’angle avec la tangente égale à « e » se révèle être précisément 69°,8024. En outre, aussi bien dans The Snefru Code partie 5 que dans The Snefru Code partie 7 nous avons vu les connexions non moins évidentes entre l’angle de base de la Pyramide Rouge et l’inclinaison de la base du Cercle de Nabta Playa, dont la somme se avère être de 90°. De cette façon les deux angles sont réciproques sur le quart de l’angle plein, comme on peut voir dans la photo ci-dessous

Eh bien, l’angle de base du Cercle de Nabta Playa par rapport à l’axe nord-sud, égal à environ 46°,50, a une tangente pratiquement égale à 1,054571, ou à la valeur de « hache coupé » (le symbole est « ħ », une variante de « h », la constante de Planck, dont la découverte est à la base de la mécanique quantique). Le cercle entre physique, astronomie et géométrie (au moins dans la conception ancienne) se ferme lorsque nous découvrons que ce même angle a un sinus égal à 0,7256. Ce nombre multiplié par 100 nous donne la durée des années solaires d’un jour de précession, et diffère de moins d’un millième de la mesure de l’hypoténuse d’un triangle rectangle, dont les côtés sont égaux à 1/ϕ e 1/ϕ² (rappelons en passant que à Gizeh Orion atteint une déclinaison minime variable, mais qui est de l’ordre de 8°,5 : et 8°,523 est l’angle réciproque sur le quart de l’angle plein de celui de 81°,476, dont la tangente est égale à la constante gravitationnelle G = 6,67428 (8°,59 est l’angle réciproque à celui de 81°,417, dont la tangente est égale à h = 6,626 : donc l’angle minime atteint à Gizeh par Orion pourrait exprimer une de ces deux constantes, ou peut-être au moins au niveau de l’approximation numérologique, toutes les deux).
Mais, restant à Nabta Playa, évidemment il y a des surprises quand du niveau purement géométrique nous nous déplaçons à celui astronomique. En étudiant les alignements de pierres du Cercle, on a trouvé des évidences que
1) Les constructeurs avaient des connaissances plutôt raffinées quant aux mouvements du ciel diurne et aux points cardinaux, puisque le cercle mégalithique est orienté avec une bonne précision sur l’axe nord-sud et a un alignement indiscutable avec le solstice d’été.
2) Ces connaissances s’étendaient aussi au ciel nocturne, puisque le cercle mégalithique contient ce que l’on pourrait appeler une carte stellaire, qui indique les positions des étoiles de la Ceinture et des Épaules d’Orion, respectivement autour de 4900 et de 18000 av. J.C. (voir The Snefru Code partie 6), qui à Nabta Playa représentent respectivement la hauteur maximum et minimum atteinte par Orion à l’horizon pendant un demi-cycle de précession (voir The Snefru Code partie 5).
8. Ce dernier fait déjà en lui-même est tout à fait incroyable pour l’archéologie officielle, puisque à présent on croit et enseigne que le premier qui a découvert le phénomène de la précession a été l’astronome grec Hipparque au deuxième siècle av. J.C. Pourtant cela n’épuise pas encore les « merveilles » astronomique du site. En fait, dans la même zone où se trouve le cercle ont été identifiés des alignements de menhirs, sur des distances d’environ un kilomètre, où pour les mêmes six étoiles de la Ceinture et des Épaules d’Orion on localise le moment du lever héliaque à l’équinoxe de printemps – avec des dates éloignées entre elles encore plus de 1500 années. Nous pouvons obtenir une idée visuelle de ce dont il s’agit en observant les photos ci-dessous




Une des particularités de ces alignements c’est qu’ils sont disposés d’une manière qui semble désordonnée et dépourvue de toute signification esthétique. Les menhirs placés dans des différentes positions devant ce qui agit comme un viseur (ce qui dans la photo apparaît comme au premier plan) sont placés à des distances plutôt différentes, donnant au premier moment l’impression d’avoir été placés au hasard. En effet, si nous regardons la carte des alignements (image ci-dessous) la première impression ne semble pas pouvoir être que cela
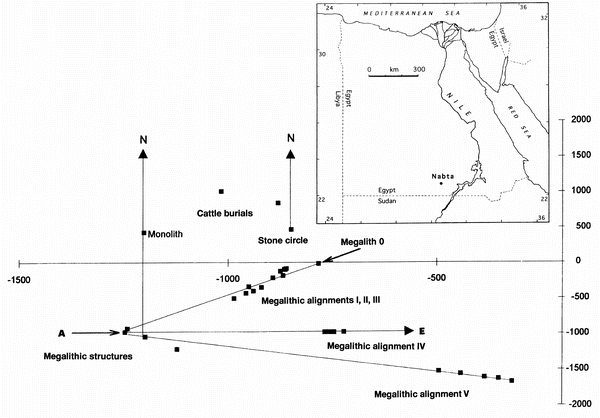
Brophy, auteur de la découverte de la connexion entre le site mégalithique et les étoiles de la Ceinture et des Épaules d’Orion, a été particulièrement surpris par cette caractéristique et il s’est longuement interrogé sur ce qui pouvait être la raison de ce désordre apparent. Au début il se demanda si les différentes distances ne pouvaient pas être liées avec le différent degré de luminosité de chaque étoile. Mais bientôt il comprit que cette explication ne tenait pas debout et que, par conséquent, la raison ne pouvait pas être celle-ci. Alors – presque par jeu – vérifia si par hasard elles pouvaient avoir relation avec les différentes distances relatives que les étoiles ont par rapport à la terre. Et, avec étonnement, il se rendit compte que la raison semblait être juste cela. Considérant le menhir-viseur comme un symbole de la terre, il remarqua que les alignements indiquaient non seulement le lever héliaque, mais aussi la distance relative des respectives étoiles de la terre. Si nous estimons 0,799 mètres de longueur comme une année-lumière, l’alignement pointant vers Bellatrix donne un résultat égal à 318 x 0,799 = 254 années-lumière. Actuellement nous mesurons cette distance en 250 années-lumière. En supposant que notre mesure est exacte, nous constatons que les astronomes de l’Ancienne Égypte auraient commis une erreur inférieure au 2%. Dans le cas de Beltegeuse l’erreur est inférieure à 0,25%.

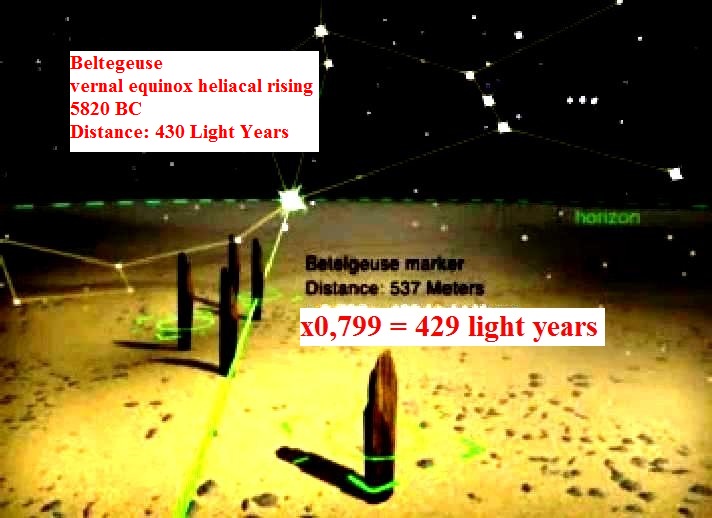
Probablement il n’y a pas des mots adéquats pour expliquer l’étonnement que peut susciter de trouver inscrites sur des pierres alignées il y a 7500 ou peut-être même 9000 années des notions de ce genre de raffinement. Qu’il suffise de dire que dans l’Occident moderne on est arrivé à mesurer la distance des étoiles de la Terre seulement en temps récents, en utilisant des instruments qui au début du XXe siècle auraient peut-être été jugés comme science-fiction. Pourtant, ces gens considéraient ceux que pour nous sont seulement des amas casuels de gaz – qui brûlent à des centaines de millions de degrés et se dispersent à une vitesse inimaginable dans le vide cosmique – des divinités auxquelles on devait prêter un culte plein de crainte et de tremblement.
Bien sûr, nous ne savons pas ce qu’était et comment sonnait le nom de la divinité que l’on voyait en Orion au moment de la construction de Nabta Playa. Mais à partir des documents écrits nous savons qu’environ trois millénaires après cette même constellation serait appelée Osiris, que le Pharaon serait considéré comme son fils Horus, qui après sa mort serait transfiguré dans son Père.
9. Il donne lieu à réflexions bien remarquables le fait que l’attitude religieuse de ces personnes n’empêchait pas la connaissance du cosmos avec les lois mathématico-quantitatives semblables à celles que nous possédons. Cela nous prouve d’une façon indiscutable que la notion du sacré n’a rien à voir avec la connaissance ou la méconnaissance de la structure physique des objets qui sont considérés comme des symboles divins. Aujourd’hui il y a des physiciens catholiques qui, tout en connaissant parfaitement la structure de la matière qui constitue une hostie, au même temps la considèrent une transfiguration du Corps du Christ. De la même manière, à Nabta Playa nous rencontrons des gens qui, tout en sachant parfaitement la structure du cosmos et la nature des étoiles, toutefois ils les considéraient le corps de leur dieux.
Dans The Snefru Code partie 4 nous avons vu que le Cercle de Nabta Playa, malgré sa rudesse apparente, semble avoir été codé dans le même diagramme de l’espace-temps dans lequel ont été codés l’art et l’architecture sacrés de l’Ancienne Égypte de la période dynastique. Plus tard, dans The Snefru Code partie 7, nous avons vu que les angles générés par les directions typiques de cette structure sont en mesure d’identifier des points cruciaux de deux diagrammes atomiques dessinés dans le siècle dernier. Il est bien de voir de nouveau ces images qui nous aideront à poursuivre notre raisonnement
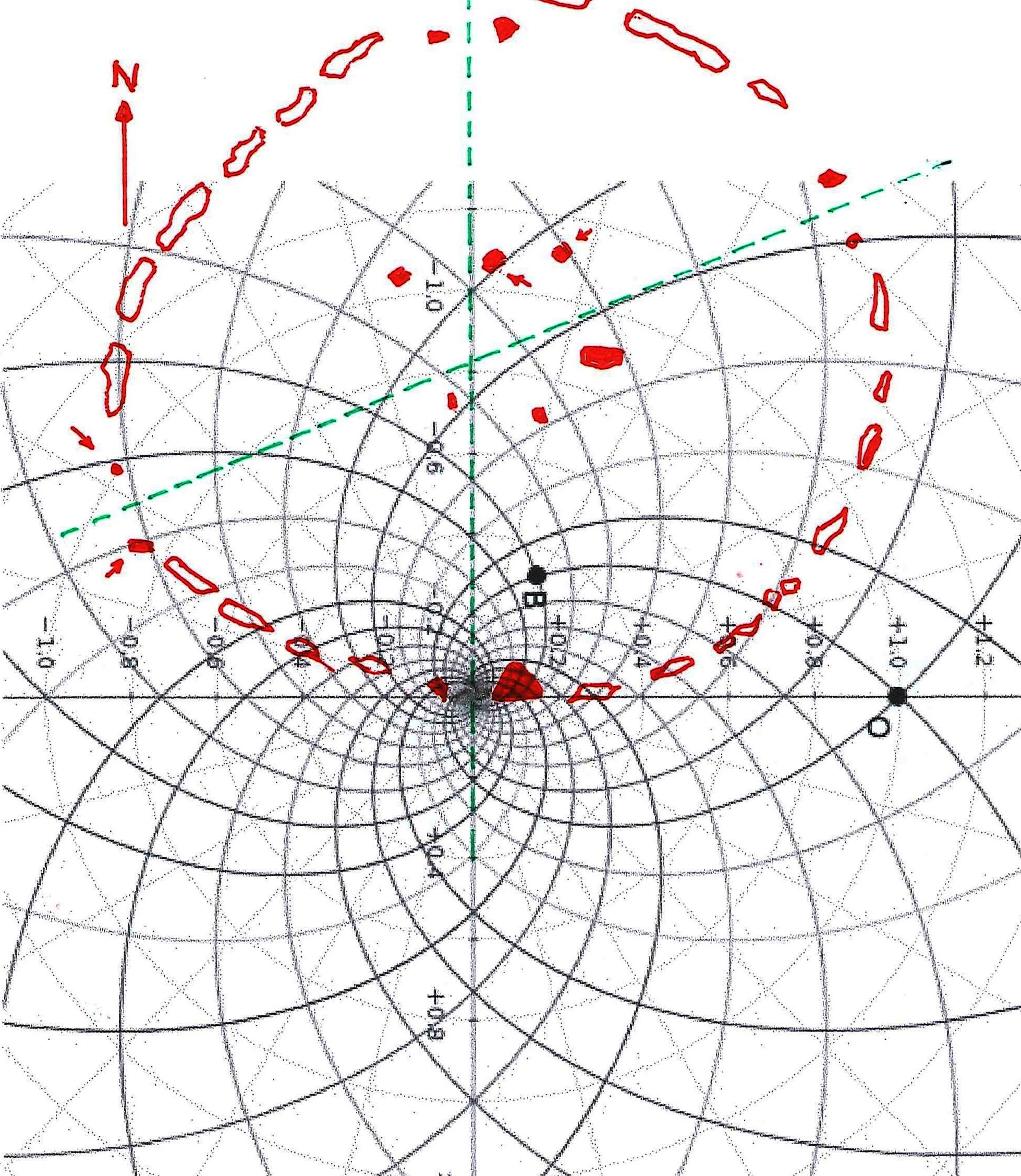
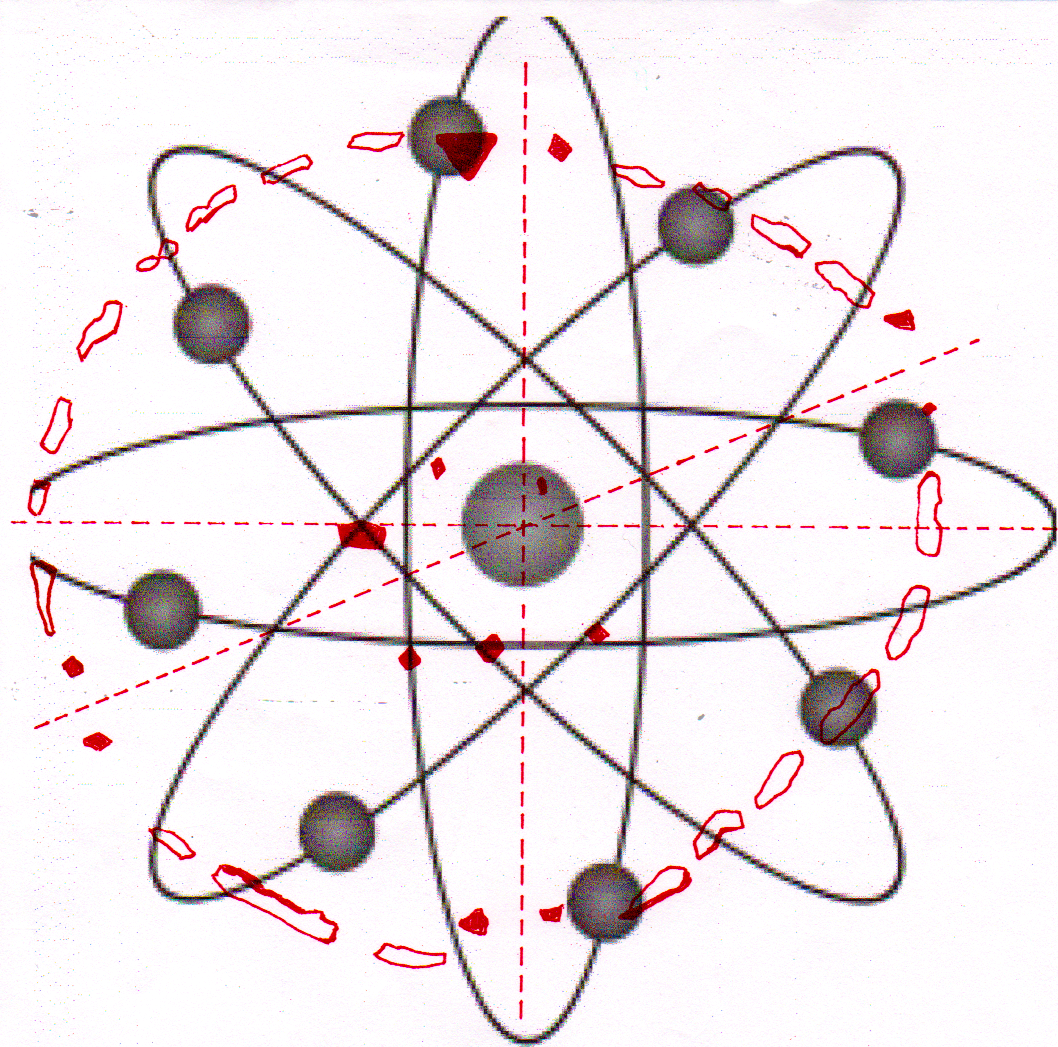

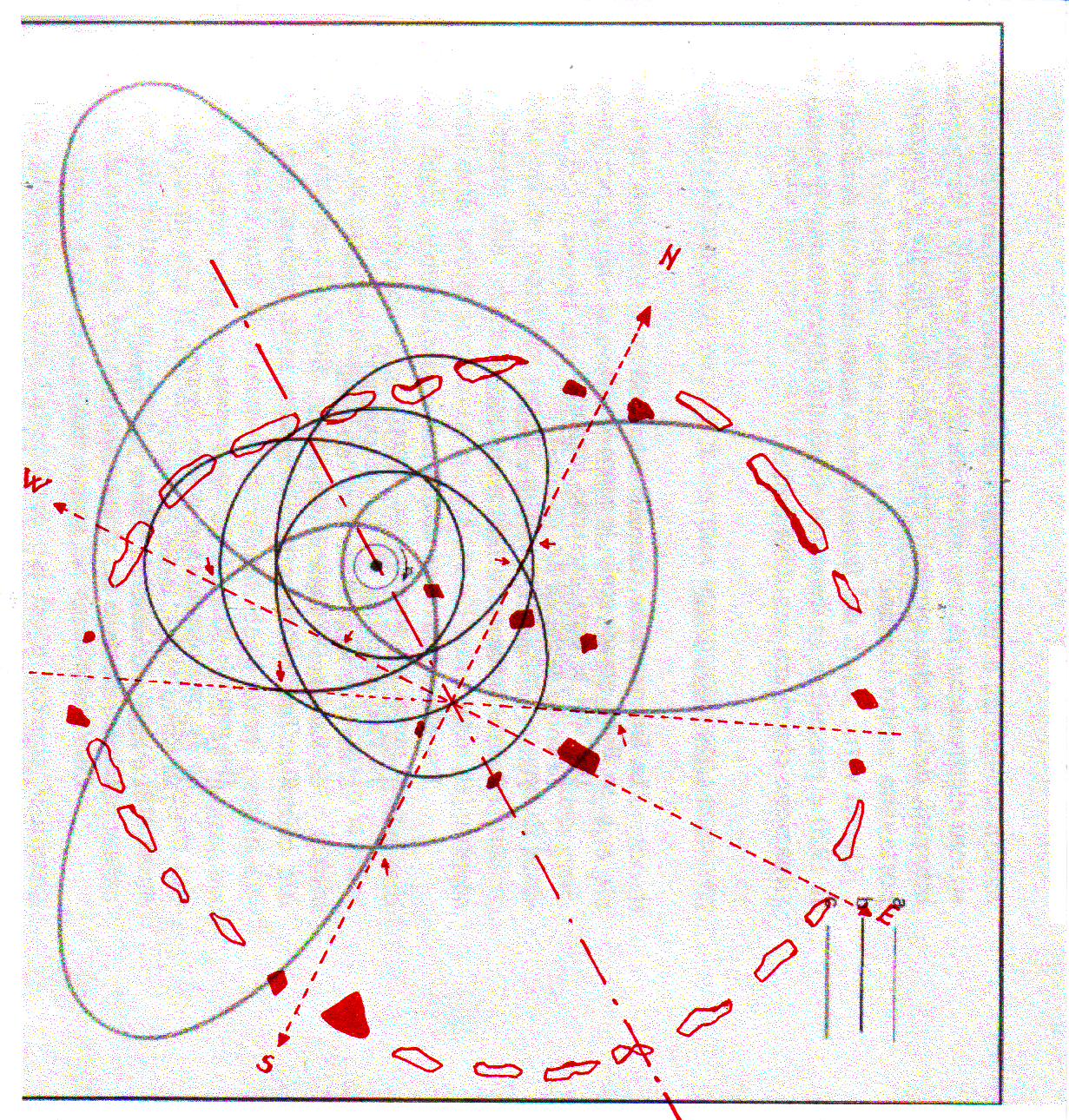
Peut-être, il y aura quelqu’un qui, en observant ces images, a pensé que les systèmes de coïncidences entre ces diagrammes et le Cercle de Nabta Playa peuvent être dues au hasard. Mais comment on peut continuer à penser une chose pareille, quand on sait que ces personnes étaient capables de mesurer même la distance des étoiles de la Terre ?
Au contraire, dans The Snefru Code partie 7, suivant le fil logique dicté par les coïncidences structurales entre l’espace sacré de l’Ancienne Égypte et nos diagrammes atomiques et gravitationnels, nous avons atteint le point de supposer que ces personnes devaient être en possession de cette théorie des champs unifiés que dans le moderne Occident nous sommes encore en train de chercher à tâtons. Et, en effet, en superposant le diagramme « d’or » de l’espace-temps élaboré par Fappalà avec celui de l’hydrogène développé par Bohr, nous avons vu que ces diagrammes semblaient avoir des points de contact structuraux que jusqu’à présent personne n’avait osé imaginer. Et, encore une fois, il sera utile rafraîchir notre mémoire et voir de nouveau ces relations géométriques qui pourraient faire allusion à des relations beaucoup plus importantes de type physique. À celles que nous avons vu dans The Snefru Code partie 7 maintenant nous en ajoutons une autre concernant l’atome du radium, qui semble confirmer les hypothèses que nous avons fait à partir des autres
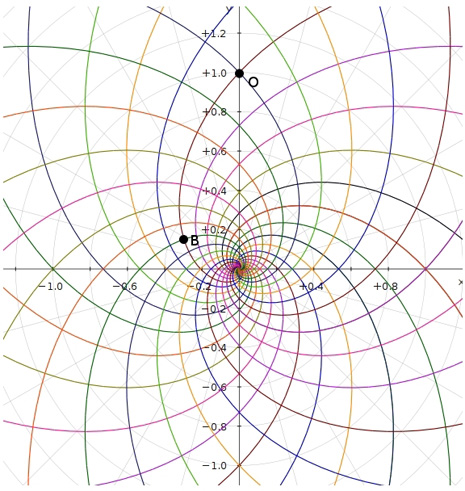
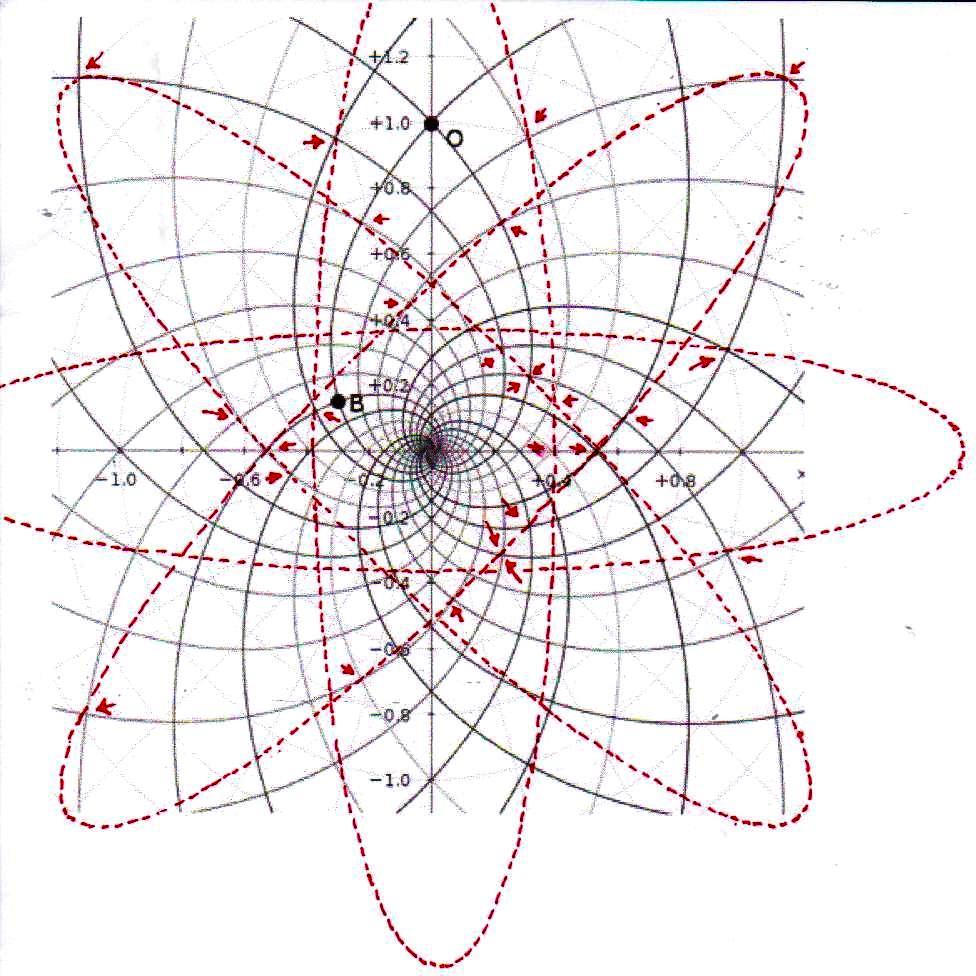
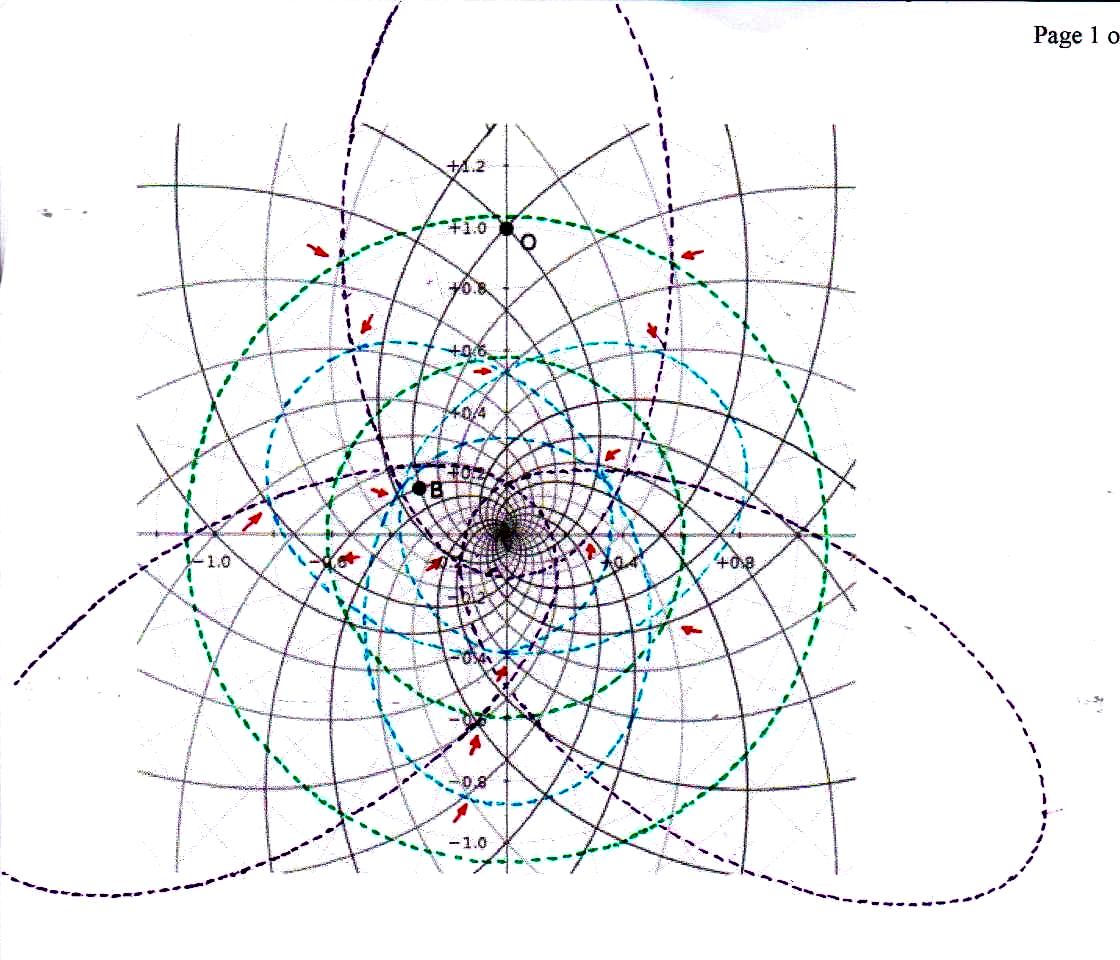
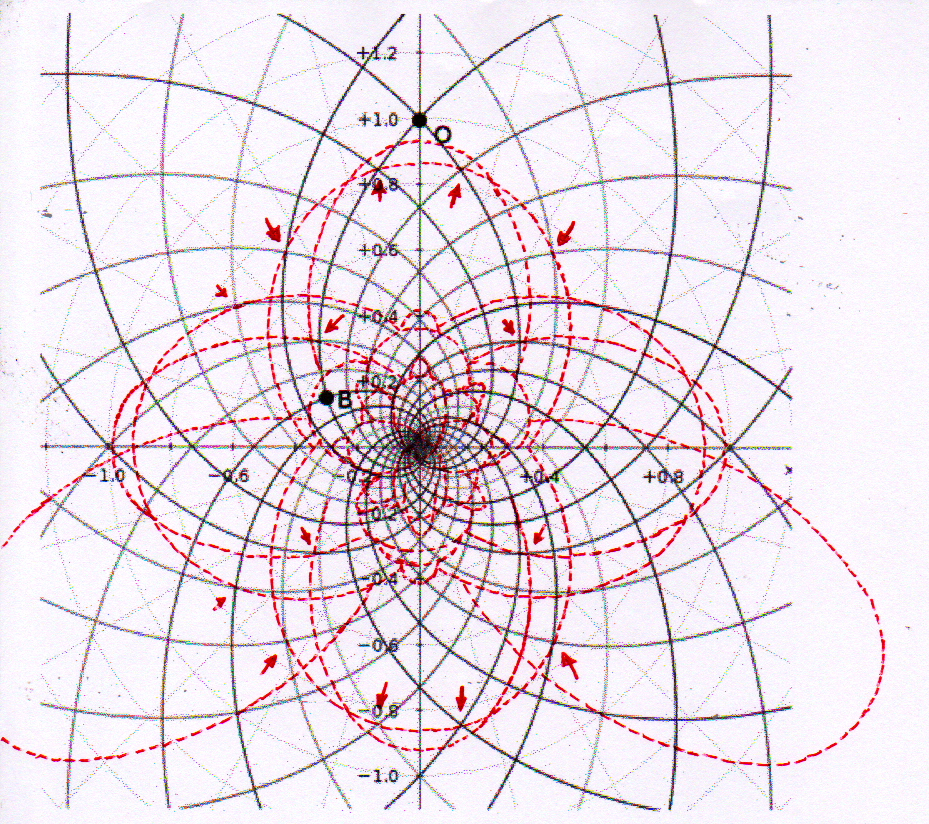
Il est intéressant de noter que dans le cas de l’atome du radium (image ci-dessus à droite), en déplaçant le diagramme de l’espace-temps dans des points différents de celui central, nous voyons de nouveau que se recréent des systèmes d’intersections. Cela semble être une autre preuve que l’espace d’or par lequel Fappalà a réussi à décrire l’espace-temps einsteinien pourrait être en mesure de définir également, pour ainsi si dire, cet espace quantique dans lequel se meuvent les électrons autour du noyau. Notez également comment le diagramme du radium semble en mesure de définir les caractéristiques géométriques importantes de la Pyramide Rouge. Tout comme, in The Snefru Code partie 7, nous avions vu que le diagramme de l’atome de l’hydrogène était capable de faire avec la Grande Pyramide
Maintenant, si en effet ces personnes étaient en possession d’une théorie physique si avancée, il ne devrait pas trop nous surprendre s’ils étaient aussi en possession de connaissances chimiques également évoluées. Des connaissances qui rendaient possible et peut-être même triviale une entreprise que pour nous est impensable : la réduction de la pierre à l’état liquide ou pâteux à froid, dont nous avons vu des traces indubitables dans les murs d’Alatri.
Ici, bien sûr, nous ne voulons pas soutenir que, à cause des traces de scie mégalithique et du traitement de la pierre à l’état pâteux qu’on a trouvé à Alatri et à Arpino, la culture d’Alatri doit être immédiatement associée à celle de l’Ancienne Égypte. En fait, à Alatri nous n’avons aucune preuve d’une science astronomique comparable à celle que l’on peut trouver sur les rives du Nil. D’autre part, on ne peut non plus nier qu’au moins dans certains points la relation soit autant indéniable que la différence. Les habitants d’Alatri, comme les anciens Égyptiens, certainement doivent être comptés parmi les soi-disant « peuples du Soleil ». Il s’agit des gens qui, contrairement à ce que soutient la doctrine évolutionniste, étaient en possession de connaissances scientifiques très avancées. Comme il ressort des traces d’une technique de traitement de la pierre, dont les êtres humains ont peut-être perdu la mémoire depuis des millénaires.
ANNEXE : Rivoli, Mars 2014
Lointain…
Si
lointain…
Lointain
et pourtant
même d’une pièce fermée
pouvoir te regarder dans les yeux
voisin,
absolument intime
et invisible
comme un miroir.
Pouvoir te suivre
le long des rues des taxis
égales
comme un labyrinthe,
dans l’immensités des aéroports
égales
comme un désert,
entre les visages des salles d’atteinte
égaux
come fantômes dans les yeux
ou comme des gouttes de pluie
qui tombent dans l’eau.
Les tableaux des horaires
dans lesquels le temps tous les jours
se défait, irréel,
comme une année entière
dans les notes d’une agenda
ou dans les nombres d’un calendrier.
La première ou la seconde classe,
la bienvenue,
les salutations et,
surtout,
les sourires…
Les sourires :
ça ne rate jamais…
Cette farce se récite partout,
et t’harcèle
et te hante
d’autant plus que les bravos,
ou les ovations :
il n’y a pas un seul rêve
qui ne se réveille pas
dans le tonnerre des acclamations,
des salutations
éclairées par le clignotement
des sourires,
mer en tempête
dont tous les jours on doit faire
l’interminable traversée
qui débarque enfin
dans un matin amère…
Il était dur de l’apprendre
et il est impossible
de l’enseigner à quelqu’un d’autre.
Celui qui ne s’arrête nulle part
est condamné aux sourires
comme le banni au bannissement,
et celui qui depuis toujours
ne le sais pas,
pour toujours restera incrédule :
personne
n’a jamais rien à réprimander
à celui qui vient juste parce que l’on a appelé,
juste parce que l’on a payé.
Pourquoi on devrait montrer le visage
de la dure vérité,
du dur amour quotidien
à celui qui jamais porte le poids du temps,
à celui qui comme un nuage léger
vient avec le vent
qui va on ne sait où ?
* *
Lointain…
Si
lointain…
* *
Si lointain,
et pourtant
savoir ce que tu penses
quand tu penses à rien.
Lointain…
Si
lointain…
Et pourtant
savoir ce que tu cherches
de là de cet horizon fermé,
de ce coucher de soleil, rouge de honte,
parce qu’un jour de plus est passé,
immobile,
comme ce ciel si fond
sans plafond,
de la fenêtre de ton avion,
ton rempart,
qui n’atterre jamais,
qui se dirige nulle part.
* *
Nulle part,
oui….
Nulle part
ou….
….lointain…
Si lointain…
* *
Lointain,
oui,
comme un aveugle :
et pourtant
pouvoir voir s’ouvrir et se défaire
les valises,
vomir vêtements,
puis avalés par la machine,
par les tiroirs,
puis dévorés encore
par ces valises insatiables,
sans cesse :
sans cesse
savourer la douleur assoupie
sous le maquillage de l’actrice
qui trompe tout le monde
sauf toi-même,
si lointaine
même
de toi-même…
Si lointaine,
oui,
que je ne peux plus même prononcer
ton nom, si cher,
et pourtant t’avoir ici,
continuellement,
inutilement perdue,
si te voir,
si lointain, pourtant, comme un aveugle,
tu le sais,
c’est mon sort pérenne,
c’est mon étrange mort,
c’est ma vie
quotidienne.
Ainsi,
inévitablement te pleurer,
inévitablement te regretter
avec des larmes qui tombent
désormais distraites,
sans commotion,
sans pudeur,
et désormais
sans aucun goût
ni dégoût.
* *
Enfin
savoir que nous sommes
comme tous.
Voir que notre mal eternel,
maternel,
c’est un destin béotien,
et s’il n’est pas mort,
tu le sais,
c’est juste parce qu’il est
mortel.
Nous aussi,
aussi les anges
sont faits de la même cendre,
étrange,
des cigarettes qui nous fumons
et qui dans les coins se mélange
à la poussière cosmique,
à la fatigue comique
du serveur qui l’époussette tous les matins,
si l’hôtel veut conserver son nom
s’il ne veut pas être considéré un fainéant,
si regarder un lit défait
me rappelle ta photo,
je ne sais pas comment.